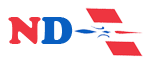Un lycée parisien s’interroge sur la fabrique des inégalités entre les sexes


Sur le papier, Saint-Louis-de-Gonzague – plus souvent appelé Franklin –, établissement jésuite du 16e arrondissement de Paris, est synonyme d’excellence. Les lycées et les écoles préparatoires arrivent en tête du classement. De plus, personne n’aurait pu prédire que la moitié de ses effectifs – les filles – étaient en fait moins motivés à réussir que les garçons.
C’est pourtant le constat d’un vaste audit lancé en 2020, quarante ans après l’ouverture à la diversité de ce lycée historiquement masculin. Ce travail vaut aujourd’hui à l’établissement une place de choix et reçoit, ce 12 juin, le label « égalité filles-garçons » du ministère. Une première dans l’enseignement catholique à Paris.
Tout a commencé en 2020, lorsque les effets du nouveau baccalauréat « à la carte » se sont fait sentir. Cette année-là, à l’échelle nationale, le nombre de filles choisissant un enseignement spécialisé en mathématiques a chuté. « Notre premier réflexe a été de nous dire : ça n’existe pas ici. » se souvient Marie Caner-Chabran, directrice adjointe. Les familles Franklin appartiennent au CSP+, maîtrisent les codes et connaissent les stratégies scolaires. « Nous avons également pensé que cela suffisait à contrebalancer la tendance nationale. » reconnaît Marie Caner-Chabran.
« L’effet de stéréotypes tenaces »
Cela n’a pas été le cas et l’établissement a donc décidé de remettre en question ses propres pratiques. Le directeur adjoint lance alors avec Fatima Aït-Said, professeur de sciences sociales en classes préparatoires, et Claire-Line Veron, préfète de l’établissement – l’équivalent d’un conseiller principal d’éducation –, un vaste audit des pratiques pédagogiques. Et rapidement, les résultats se révèlent édifiants. « Si personne à Franklin ne vient à l’esprit de désavantager consciemment les filles, elles sont soumises à l’effet de stéréotypes tenaces », résume Marie Caner-Chabran.
Ainsi, l’étude des bulletins scolaires des élèves de deuxième année montre que les évaluations ne sont pas les mêmes pour les filles et les garçons. Le premier peut être décrit comme « sérieux », ou même« agréable » ou même « souriant ». Tant de termes « jamais utilisé pour les garçons », note Fatima Aït-Said. Ils sont encouragés à « aller plus loin », « faire mieux ». Aussi, au fil de la scolarité, bulletin après bulletin, deux petites chansons bien différentes se font entendre : « Les filles reçoivent le message insidieux selon lequel elles réussissent parce qu’elles travaillent mais pas parce qu’elles sont talentueuses, tandis que les garçons croient qu’il leur suffit de vouloir pouvoir le faire. » résume le chercheur.
La discipline n’est d’ailleurs pas tout à fait la même pour les filles et les garçons, ces derniers bénéficiant de plus de tolérance. « Ils se comportent globalement moins bien, mais sont plus facilement excusables. L’idée derrière tout cela est qu’ils ont un besoin naturel de bouger. A comportement égal, une fille sera plus vite perçue comme agitée. décrit plus en détail le chercheur.
Conséquences sur la confiance en soi
Toutefois, ces différences d’appréciation, répétées année après année, ne sont pas sans conséquences sur la confiance en soi et l’ambition. Un chiffre résume l’énorme écart : en 2022, alors qu’ils obtiennent tous deux des notes très similaires au baccalauréat, 53 % des élèves masculins de dernière année se sont tournés vers des carrières d’ingénieur contre seulement 18 % des filles.
Depuis, la prise de conscience s’est accrue. Plusieurs projets ont été lancés : réécrire le règlement intérieur, créer un centre étudiant pour encourager les jeux de société, ou encore organiser des ateliers pour sensibiliser aux stéréotypes de genre. D’ailleurs, en ce jour de juin, une dizaine d’élèves de sixième débattent de la force des idées reçues. Tout le monde dessine un morceau de papier sur lequel une déclaration comme « les garçons ne pleurent jamais », « les femmes cuisinent », etc. L’occasion de débattre, d’apprendre à penser par soi-même, et aussi de se faire plaisir. Les garçons admettent qu’on se moque de eux lorsqu’ils ne jouent pas au football.
Beaucoup citent leur père, qui « sait très bien s’occuper des enfants ». Nathanaël parle de ses lectures en français : » Nous étudions L’Odysséeet Ulysse pleure beaucoup même si c’est un héros très vaillant », il explique. On cherche un peu les noms de footballeurs français, tandis que Colette remarque « que, dans « Top Chef », il y a beaucoup plus d’hommes qui cuisinent ». Une mesure prise par l’établissement fait l’unanimité : les deux journées sans bal organisées chaque semaine. « C’est plus calme dans la cour, et on joue à chat, c’est sympa aussi ! « , conclut le petit groupe.
—-
Différences de choix d’études dans l’enseignement supérieur selon le sexe
Au niveau national, les étudiants représentent :
– 42% les étudiants des grandes écoles et 28% inscription dans une école d’ingénieurs ;
– 40% les secteurs les plus lucratifs des écoles de commerce (finance) ;
– 28% les étudiants en sciences fondamentales à l’université ;
– 70% des étudiants en médecine de première année sont des filles, et 85% en formation paramédicale ;
– 70% des étudiants en langues, lettres et sciences humaines à l’université sont des filles.