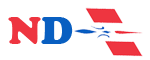Emmanuel Macron est arrivé ce mercredi matin à Madagascar avec sa femme. Sur le tarmac de l’aéroport d’Ivato, récemment construit par la société française ADP, le couple s’est présenté sur un tapis rouge bordé par une foule d’enfants avec des chapeaux Raphia. 80% de la production mondiale de Raffia est malgache.
Cette fibre, reconnue pour son bon compromis entre la flexibilité et la solidité, provient de feuilles gigantesques d’une espèce de palmier qui peut atteindre jusqu’à 20 mètres de haut. Au cours des quatre dernières années, les importations européennes de ce matériel de Madagascar ont augmenté de 20%. Cependant, la production reste principalement artisanale.
Un espace agricole commun difficile
Du côté malgache, la production agricole est l’un des principaux défis de cette visite d’État par Emmanuel Macron. Le président Andry Rajoelina a assuré que » Plusieurs accords d’accords dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation, de l’énergie et des infrastructures » devrait être signé lors de cette réunion. À Antananarivo, nous espérons créer un espace agricole commun au sein de la Commission de l’océan Indien. Sujet délicat depuis la réunion – intégré à l’UE – est membre de la commission aux côtés de Comores, Seychelles, Maurice et Madagascar. Dans ce dernier pays, l’agriculture continue de contribuer jusqu’à un quart du PIB et la majeure partie de la production est la nourriture, le signe d’une petite économie développée et où les terres les plus fertiles sont vendues à des groupes étrangers. L’affaire Daewoo est l’exemple le plus frappant: en 2007, contre 6 milliards d’euros sur 20 ans, le gouvernement malgache a vendu 1,3 million d’hectares de terrain – l’équivalent de la Belgique – à la société coréenne Daewoo. Aujourd’hui, alors que de nombreux entrepreneurs français de tous les secteurs accompagnent le président, le malgache ne veut pas reproduire leurs erreurs préférant le « co-investissement ». C’est dans le secteur de l’énergie que le co-investissement est attendu et qu’un contrat doit être signé. EDF devrait intégrer le consortium opérant le barrage Volobe aux côtés de la société d’énergie malgache Jirama. Ce projet estimé à 600 millions d’euros – l’Union européenne a déjà investi 20 millions l’année dernière – est attendue depuis plus de 20 ans à Madagascar. Mais les appels successifs à des offres et à une corruption importante au sein de Jirama ont retardé la réalisation essentielle de cette installation qui devrait produire 40% de la consommation de l’île. Sur le site, seulement 36% des habitants ont accès à l’électricité contre 50% en moyenne en Afrique. Difficile avec un tel réseau pour consolider l’économie nationale. Mais la construction du barrage ne résoudra pas à elle seule le mal qui mange l’un des 44 pays les moins avancés du monde. Pour le Fonds monétaire international, la condition préalable à la réalisation des projets énergétiques à Madagascar est une réforme du Jirama. Actuellement, la société vend son électricité 15 cents de moins que de l’acheter, forçant l’État à dépenser 250 millions d’euros chaque année pour le reconstituer, soit 10% de son budget. Il n’y a donc rien pour s’assurer que le Jirama aura la capacité d’acheter l’électricité du futur barrage si son prix est trop élevé. En plus de l’énergie, Antananarivo a pris la parole, en amont de l’arrivée d’Emmanuel Macron, d’éventuelles négociations sur une effacement de la dette malgache, sans plus de détails. Dans un pays où la pauvreté affecte 75% de la population, l’arrivée du président français et d’une vingtaine de chefs d’entreprise est vécue comme une véritable opportunité. Une opportunité d’investissement (énergie, infrastructure, télécommunications, agriculture, etc.) mais aussi une chance de renégociation (dette, souveraineté de certains territoires dans l’océan Indien). Alors que le chef de l’État français sort d’un passage express dans les retrouvailles, critiqué pour son manque de solutions aux préoccupations locales, la visite de l’État à Madagascar, très économique, ne sera pas résumé dans une succession de symboles.Énergie au cœur de la visite
Dette et souveraineté