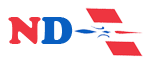Sur le littoral aquitain, mesurer l’érosion côtière pour mieux s’y adapter

Chaque printemps, ils arpentent plages, dunes et falaises avec leurs outils de mesure : les techniciens de l’Observatoire du littoral de Nouvelle-Aquitaine cartographient le retrait du trait de côte, qui menace les habitations et les activités économiques, pour contribuer à définir des stratégies d’aménagement.
Depuis vingt ans, les données sont collectées d’avril à juin, de « transects »des lignes virtuelles perpendiculaires au littoral, qui permettent d’évaluer l’évolution du stock de sable, mais aussi celle des dunes et des falaises, grâce au GPS avec une précision centimétrique.
De l’embouchure de la Gironde, au nord, jusqu’à la frontière espagnole au Pays basque, au sud, 185 profils sont dressés après avoir été malmenés par les tempêtes hivernales.

Des salariés de l’Observatoire de la Côte de Nouvelle Aquitaine réalisent des relevés cartographiques de l’érosion du littoral basque à Guéthary, dans les Pyrénées-Atlantiques, le 10 juin 2024 / GAIZKA IROZ / AFP
« Le risque naturel, c’est l’érosion ou la submersion marine, et l’enjeu est la maison qui sera située au-dessus de la plage : les deux partenaires constituent le risque »explique Lisa Martins, ingénieure risques côtiers au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), associée à l’Office national des forêts au sein de l’Observatoire.
Ces travaux visent notamment à éclairer les décideurs publics sur leurs stratégies d’aménagement d’un territoire dont 6 000 logements pourraient être menacés par l’érosion côtière d’ici 2050.
Ainsi, le BRGM s’associe à différents travaux en cours, comme celui réalisé à Bidart, au Pays basque, autour d’un golf à flanc de falaise dont une partie du parcours doit être relocalisée. Ou encore, un projet d’aménagement à Saint-Jean-de-Luz, qui doit, dans les années à venir, renaturer une partie de son bord de mer, y réduire les activités économiques et y déplacer une station d’épuration.
Oléron particulièrement menacé
Avec ses 840 kilomètres de littoral, la Nouvelle-Aquitaine est confrontée à différentes problématiques. Sa côte sableuse, en Gironde et dans les Landes, recule de 1,7 à 2,5 mètres par an. En Charente-Maritime, au cours de la dernière décennie, la façade ouest de l’île d’Oléron a reculé de 20 mètres par an en moyenne, ce qui en fait le taux de recul du littoral le plus élevé d’Europe, selon les chiffres. de l’Observatoire.
Pour sa partie rocheuse, au Pays Basque, l’évolution se mesure en éboulements et glissements de terrain. « Le littoral sableux a une résilience que la côte rocheuse n’a pas car en été, la plage peut se reconstituer en sable, soit naturellement, soit par l’action anthropique des communautés »souligne Lisa Martins.

Des salariés de l’Observatoire de la Côte de Nouvelle Aquitaine réalisent des relevés cartographiques de l’érosion du littoral basque à Guéthary, dans les Pyrénées-Atlantiques, le 10 juin 2024 / GAIZKA IROZ / AFP
D’ici 2100, les experts du GIEC prévoient une élévation du niveau de la mer comprise entre 60 cm et 1 m. Ce phénomène entraînera une hausse de la limite des hautes marées sur les rives, notamment dans les estuaires. Lors de marées hautes ou de fortes houles, l’impact des vagues sera plus fort sur le littoral et renforcera les processus d’érosion et de submersion.
« Il y a aussi un rôle important pour les précipitations », ajoute l’ingénieur, « avec le ruissellement des eaux qui vont s’infiltrer du haut de la falaise » et l’affaiblir.
« Nous savons aujourd’hui qu’il y aura un impact sur toutes les variables météorologiques comme la houle ou les précipitations, ce qui affectera l’intensité et la fréquence des événements »se souvient Lisa Martins. « Ce qui n’est pas encore connu, c’est l’impact sur l’érosion. Quel effet si les épisodes pluvieux sont plus ou moins intenses, ou plus ou moins nombreux ? Nous n’avons pas les réponses. »