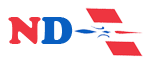ressentiment contre l’Allemagne, sexisme, optimisme, star Johnny Weissmuller… Comment se sont déroulés les Jeux Olympiques de Paris en 1924 ?

Un autre monde. Une autre époque. La superposition des deux images de Paris à 100 ans d’intervalle n’est pas sans rappeler ces kaléidoscopes où, certes, les formes subsistent, mais la vue d’ensemble est complètement floue. Les symboles et monuments historiques sont toujours là, mais à l’heure d’accueillir ses troisièmes Jeux olympiques, la capitale française n’a plus rien à voir avec cette ville sortie épuisée et brisée de la Première Guerre mondiale. Victorieuse, oui, mais elle en avait payé le prix.
Pourtant, soucieuse de son rayonnement à l’étranger et d’un prestige à restaurer, la France avait pesé de tout son poids pour obtenir ces Jeux. Et l’influence du baron de Coubertin au sein du CIO a fini par faire pencher la balance en faveur de Paris, alors qu’Amsterdam était donné grand favori. L’ambiance générale était à la fierté nationale. Parce que le moment était propice. « L’entre-deux-guerres fut une phase très intense de démocratisation et de spectaculaireisation du sport »contextualise Stanislas Frenkiel, historien à l’Université d’Artois et créateur de la première chaîne YouTube sur l’histoire du sport.
La flamme après les cendres
Ce spécialiste souligne l’affirmation inexorable du sport-spectacle qui fait vibrer la capitale : « Il y a un engouement populaire inévitable car le milieu des années 1920 offrait encore la possibilité de concourir pacifiquement par le sport et de rivaliser avec les Américains qui avaient tout gagné lors des Jeux interalliés de Paris en 1919. » Tout est donc réuni pour que ces deuxièmes Jeux olympiques organisés à Paris, après ceux beaucoup plus confidentiels de 1900, soient une fête. Même si, pour des raisons financières, la Ville Lumière a dû resserrer son budget. Du prestige oui, mais sans opulence ostentatoire.
Selon l’INSEE, cité par La Croix (article payant), le coût de ces Jeux de 1924 a été établi à 15 millions d’anciens francs, soit 22 867 euros. Rien à voir avec le budget alloué à Paris un siècle plus tard (près de 9 milliards d’euros selon les dernières estimations). Symbole de cette maîtrise raisonnable des dépenses, le stade de Colombes, agrandi pour accueillir la cérémonie d’ouverture et de nombreux événements (pour atteindre 45 000 places), fait pâle figure en comparaison du gigantisme de Wembley (127 000 places à l’origine), construit à la même époque à Londres. Malgré ces nombreuses restrictions, ces Jeux sont, à bien des égards, considérés comme les premiers de l’ère moderne et c’est dans ce lieu de Colombes que défilent, sous les yeux du président français Gaston Doumergue et du prince de Galles, les 44 délégations présent. Mais pas l’Allemagne.

Cette fois, même le pouvoir de Coubertin, qui œuvrait pour la participation aux Jeux olympiques des pays battus, n’aura pas suffi. « Les Jeux sont un espace de rencontre entre athlètes de différents pays et il existe une forme de diplomatie olympique », note Nicolas Bancel, spécialiste, entre autres, de l’histoire du sport et auteur d’une vingtaine d’ouvrages. Ce dernier précise qu’il y aurait eu « Une forme de logique dans la mesure où ces Jeux de Paris sont ceux de la réconciliation, et non ceux des vainqueurs comme le titrait alors la presse. » Mais, à l’instar des innombrables veuves de guerre mendiant autour des stades, les cicatrices de la guerre contre l’Allemagne étaient encore trop visibles.
« Les prémices d’un sport qui se politise »
Nicolas Bancel en témoigne « Les blessures sont encore brûlantes, notamment dans le nord de la France et en Belgique. Il y a encore plus d’un million de « visages brisés » qui errent dans les rues, les privations sont encore nombreuses et nous sommes en pleine période de tension internationale avec l’Allemagne depuis la invasion de la Ruhr en 1923 (La France y envoie des troupes coloniales pour forcer l’Allemagne à payer ses dettes de guerre)« .
« Le ressentiment envers l’ancien ennemi est toujours très fort. Pour reprendre le langage de l’époque, ‘le Boche’, on ne veut pas le voir à Paris. »
Nicolas Bancel, historiensur franceinfo : le sport
D’autant que, comme le rappelle Stanislas Frenkiel, l’entre-deux-guerres marque aussi l’avènement du nationalisme dans le sport : « Bien sûr, nous sommes encore au début de 1924, Hitler, Franco ou Mussolini ne sont pas encore au pouvoir, mais il y a déjà les prémices d’un sport qui se politise, qui devient l’indice de la vitalité d’un peuple, la vitrine de un régime et surtout un instrument de propagande. »
Ces Jeux sont donc ceux des vainqueurs, sinon ceux de la parité, notion complètement abstruse à l’époque. Au total, 3 089 sportifs sont présents à Paris, dont… 135 femmes. «C’est complètement ridicule.poursuit Nicolas Bancel. Cela allait à l’encontre de la volonté de Pierre de Coubertin qui parlait de « JO féminins » et avait une vision très conservatrice. Ses motivations ne suivaient pas une certaine tendance médicale selon laquelle l’effort physique pourrait entraver la capacité des femmes à accoucher, mais elles étaient plutôt guidées par la conception d’un ordre social très genré dans lequel les hommes ont un rôle de direction et où les femmes doivent rester à leur place. maisonpoursuit l’historien. Cette représentation féminine est donc plus symbolique qu’autre chose. » Il nuance toutefois : « À partir des années 1920, le développement du sport féminin devient de plus en plus indépendant, même si cet essor concerne principalement la bourgeoisie. »
Lorsque les femmes concourent, c’est souvent en jupes longues. Car revenir aux Jeux de 1924, c’est aussi revenir à l’époque où les athlètes étaient encore amateurs, mais aussi à l’époque des premiers crampons vissés et des cuissards trop larges qui ralentissaient les sprinteurs. Ce qui n’empêche pas certains athlètes de laisser leur nom à la postérité lors de ces Jeux qui seront ceux du Finlandais Paavo Nurmi, avec notamment deux victoires sur le 1 500 m et le 5 000 m course à pied à moins de deux heures d’intervalle ! Un autre athlète survolera la compétition, avant de sauter de liane en liane quelques années plus tard à Hollywood : Johnny « Tarzan » Weissmuller, quatre fois médaillé en poules.
La France, troisième au classement des médailles
Le futur roi de la jungle dut cependant partager cette année-là la vedette avec un certain Norris Williams, survivant du Titanic coulé douze ans plus tôt. Lui, qui avait frôlé l’amputation après avoir survécu au naufrage en nageant dans des eaux gelées, a remporté le double mixte au tennis et a écrit, à sa manière, la légende des Jeux. Côté français, le héros de la nation s’appelle Roger Ducret. Ancien prisonnier de la Première Guerre mondiale, l’escrimeur brille dans toutes les disciplines (fleuret, épée, sabre) et contribue grandement à placer le pays hôte à la 3e place du tableau des médailles derrière les États-Unis et la Finlande.

D’autres anecdotes, qui passeraient aujourd’hui pour des anachronismes, témoignent de ces époques lointaines. Ainsi, Eric Liddell, grand favori de la première épreuve d’athlétisme du 100 m et fervent chrétien, a refusé de donner le départ aux éliminatoires de l’épreuve car elles étaient programmées un dimanche. Le Britannique, invoquant le repos obligatoire le jour du sabbat, a signé un acte de foi qui est à l’origine du célèbre film « Chariots de feu ».
La liesse populaire qui accompagne tous ces exploits contribue à panser les blessures de la guerre dans un Paris en pleine reconstruction. Les questions de sécurité, qui hantent aujourd’hui les responsables de Paris 2024, étaient alors complètement marginales : « L’insécurité ne pèse que sur les affrontements qui se transforment en bagarres dans les sports collectifs ou en dérives de supporters.rappelle Nicolas Bancel. Les appareils sont alors très minimalistes par rapport à ce que l’on connaît aujourd’hui. Les problèmes sont essentiellement périphériques et sont réglés par quelques gendarmes postés aux abords des stades. »
Une quasi-insouciance qui se reflète dans l’optimisme qui secoua la capitale en 1924, comme le conclut Nicolas Bancel : « C’est une période où l’on rattrape assez vite le retard de la production industrielle d’avant-guerre et où l’optimisme prédomine. L’ambiance qui règne dans la capitale est bien plus joyeuse, on est dans le Paris de Joséphine Baker, le jazz, le Quartier Latin… Même si elle était déjà réputée, la ville acquiert encore davantage de reconnaissance comme référence culturelle et cosmopolite. » Une réputation que Paris devra réaffirmer, un siècle plus tard.