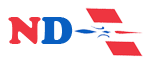Qualité de l’enseignement, périodes de prédilection, importance de la discipline… Ce que les jeunes pensent des cours d’histoire

Une étude commandée par l’Observatoire Histoire & Vie publique – mis en place par la Fondation Napoléon – et réalisée par l’Ifop interroge les jeunes sur leur perception de l’enseignement de la discipline au collège et au lycée.
Début 2024, une enquête Opinion Way auprès de Là Dimanche de la tribune alarmés : Révolution française, Holocauste, laïcité… Les 16-24 ans affichent des écarts culturels et historiques persistants. De qui est-ce la faute ? Aux programmes ? Aux professeurs d’histoire ? En cours ? Une nouvelle étude réalisée par l’Ifop pour l’Observatoire Histoire & Vie publique, créé par la Fondation Napoléon, montre que les jeunes* apprécient la matière, qu’ils soient au collège ou au lycée.
Derrière les mathématiques, l’histoire est la deuxième matière préférée, selon les personnes interrogées : 13% d’entre eux la placent même en première position et 24% en deuxième position. Le podium est complété par les langues vivantes. 75% des jeunes consultés déclarent aimer l’histoire et 77% expliquent aimer les cours d’histoire qu’ils suivent au collège ou au lycée. Un bon point pour les professeurs dont la qualité d’enseignement est saluée par ceux qui aiment la matière. » Nous avons été les premiers surpris par ces résultats. Ne pas connaître une date ou ignorer un fait ne veut pas dire que l’histoire ne vous intéresse pas.se réjouit l’historien Pierre Branda, également directeur de l’Observatoire Histoire & Vie publique. L’étude montre en effet l’importance des « story tellers » que sont les enseignants, largement salués par les personnes interrogées. Après le drame qui a frappé notre pays, avec l’assassinat de Samuel Paty, les jeunes envoient un message fort d’optimisme. C’est un merveilleux hommage à tous les enseignants et à leurs nombreux sacrifices. »
Les jeunes veulent apprendre l’histoire de France
Autre fait intéressant : ce que les jeunes attendent d’un cours d’histoire. Pour 46% des personnes interrogées, l’enseignement de l’histoire de France devrait être prioritaire sur celui du monde (42%) et celui de l’Europe (seulement 12% !). » L’attente émerge d’un enseignement de l’histoire plus « micro » centré sur la vie quotidienne des hommes, et plus que sur l’incarnation des reines et des rois. C’est le passage d’une proximité admirative avec l’histoire à une proximité identificatoire (celle avec des gens comme nous en leur temps) qui s’observe. », ajoute Frédéric Dabi, directeur général Opinion Groupe Ifop.
Lorsqu’on leur demande quelles périodes ont été « les mieux » enseignées, on retrouve : la Seconde Guerre mondiale (87 % des jeunes jugent les enseignements satisfaisants), la Première Guerre mondiale (85 %), la Révolution française (80 %). La Shoah suit avec 72% des jeunes qui jugent l’éducation satisfaisante. A l’inverse, ils sont plus critiques à l’égard des cours sur Napoléon (38% insatisfaisants), la guerre d’Algérie (43%), la révolution russe de 1917 (46%) et le conflit israélo-palestinien (48%). %). » Le point commun de ces périodes est qu’elles résonnent toujours dans l’actualité et sont souvent hystérisées dans la sphère politico-médiatique et sur les réseaux sociaux.analyse Frédéric Dabi. Dans ce contexte, l’école reflète les fractures à l’œuvre dans la société, ce qui constitue un véritable défi pour l’enseignant. A l’inverse, notons que l’enseignement de la Shoah échappe heureusement à ces divisions. »
L’institut de sondage a également interrogé les jeunes sur ce que leur apporte leur connaissance de l’histoire. Pour 82% d’entre eux, c’est utile pour former de bons citoyens et 70% pour leur vie personnelle (contre 58% pour la vie professionnelle). 87% d’entre eux estiment qu’il est important pour comprendre le monde contemporain et son évolution, 86% pour développer l’esprit critique et 85% pour former de bons citoyens. » On pense à la célèbre phrase de Churchill : « Un pays qui ne connaît pas son passé n’a pas d’avenir ». Eh bien, ils adhèrent pleinement à ce message, préférant développer leur propre esprit critique plutôt que de recevoir une instruction civique qu’ils jugent sans doute trop dogmatique ou conceptuelle. », conclut Pierre Branda.
*Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans, selon la méthode des quotas.