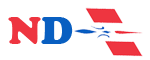Mufasa a laissé Antoine plus que perplexe quant à son utilisation de l’animation en 3D photoréaliste. Ça méritait bien un édito.
Même si ça peut sembler difficile à croire, Mufasa : Le Roi Lion me trotte dans la tête depuis mon visionnage au cinéma. Non pas que le film m’ait touché ou passionné, puisque c’est même tout l’inverse : j’ai été étonné par mon absence totale d’émotions, y compris en ce qui concerne les triggers nostalgiques attendus d’un film qui a bercé mon enfance.
C’est aussi pour cette raison que je tenais à écrire cet édito à la première personne. Même avec la distance critique de mise, je m’estime être très bon public, et je pense qu’il est assez facile pour un film de m’emporter dans son histoire. Pour être franc, j’avais peu d’espoir d’être conquis par Mufasa après la critique de Déborah, qui me semblait dans la continuité logique de mon propre avis sur Le Roi Lion de 2019.
Déception totale
Pourtant, la veille de mon retour chez ma famille pour les vacances de Noël, j’ai tenu à voir le prequel séance tenante sur le bel écran géant du Grand Rex. Sans doute qu’une part de moi espérait capter un pourcentage infime de magie enfantine avant le début des fêtes, tandis qu’une autre part avait la curiosité morbide de voir Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight et Si Beale Street pouvait parler, se fourvoyer sur un tel blockbuster, comme on ralentit devant un accident de la route.
Sauf que sur le moment, Mufasa n’a même pas réussi à me décevoir ou à m’agacer pour que je sorte de la salle furieux. Mon sentiment se résumait à un ennui poli, que j’ai très vite mis sur le dos des codes ronflants du prequel nostalgique (comment Scar est-il devenu Scar ? Comment le Rocher des lions est-il devenu le Rocher des lions ?) et de la gestion rythmique atroce d’un deuxième acte qui traîne la patte – ironique pour des animaux en plein voyage.


Mais le pire, c’est que jamais le film n’est parvenu à m’émerveiller pour la vitrine technologique qu’il est. Bien que je sois loin d’être un expert dans le domaine des VFX, ceux qui commencent à me connaître sur Ecran Large savent que le sujet me passionne, et peut même me faire pardonner dans certains cas les errances narratives d’un film.
Malgré toute la détestation que j’ai pour Le Roi Lion de 2019 et sa démarche de copier-coller imbécile, j’y détecte aussi en de rares instants la soif d’expérimentation technique de Jon Favreau, seule velléité d’un projet impossible à rendre intéressant. Au-delà de son approche novatrice de la caméra virtuelle, la qualité des fourrures, de l’eau ou des effets de lumière avaient réussi sur quelques plans à me subjuguer, surtout avec le référent de 1994 en tête.
Au fond, j’attendais au moins la même chose de Mufasa. Quitte à être déphasé de son récit, j’espérais que sa maestria visuelle me laisse pantois d’admiration envers ses centaines de petites mains d’animateurs concernées. A ma propre surprise, je n’ai été bouche bée qu’une fois, le temps d’un plan dont je n’ose imaginer la complexité, où Rafiki se met à faire l’ange dans l’une des plus belles neiges en CGI que j’ai pu voir.


Lions vs Na’vis
Si je me lance dans cet édito, ce n’est pas tant à cause de ce manque d’effet “wahou”, qui a forcément perdu de son attrait depuis le premier film. C’est pour interroger le sentiment étrange de malaise que j’ai expérimenté devant Mufasa. Régulièrement, je sentais le besoin de me détourner quelques secondes de l’écran, comme si je rejetais les images et leur photoréalisme. Plus le long-métrage me criait au visage qu’il se voulait au plus près du réel, plus sa démarche me semblait fausse.
Bien sûr, je pourrais pointer du doigt l’évidence : l’inextricable paradoxe de mettre en scène des animaux numériques “réalistes”, tout en forçant leur anthropomorphisation. Il est clair qu’une partie du problème réside dans cette balance impossible, surtout lorsque la lecture du film se montre peu aidée par un montage qui accumule les champs-contrechamps sur des créatures peu expressives et quasi-identiques physiquement.


Pourtant, mon “dégoût” (faute de meilleur terme) dépassait largement cette uncanny valley, sans que je parvienne à mettre le doigt dessus. Fort heureusement, dans ma famille, le retour à la maison pendant la période de Noël amène souvent la télé à être allumée, et même en pleine session jeu de société, j’ai demandé à ce qu’on laisse en fond la diffusion sur TF1 d’Avatar 2 : La Voie de l’eau.
J’ai beau commencer à connaître le film par cœur (je dois en être au moins à mon dixième visionnage), il n’a pas fallu longtemps pour que je sois de nouveau transporté sur Pandora, et qu’à l’inverse de Mufasa, je ne remette jamais en question la vérité de son monde et son immersion. Et c’est là que j’ai compris ce qui clochait avec le prequel Disney.


CG Aïe
L’ancrage d’Avatar, c’est avant tout celui de sa caméra. Même au gré de ses prouesses technologiques, James Cameron a tout le long de sa carrière assuré que sa mise en scène soit logique par rapport à l’espace qu’il filme, qu’il soit virtuel ou pas. Dans le cas d’Avatar, son découpage est régi comme si une machinerie traditionnelle du cinéma était employée sur Pandora. On y croise de la caméra à l’épaule, quelques zooms vifs, et même les travellings spectaculaires pourraient provenir d’hélicoptères ou d’objectifs sanglés sur les ikrans des personnages.
En bref, l’espace de la planète imaginaire influe directement sur l’image d’Avatar et ses mouvements de caméra, qu’il s’agisse de ses effets de lumière, de l’eau et plus généralement des éléments croisés. Sans qu’on ait besoin d’y prêter attention, ce sens du détail permet à Cameron de mettre en valeur les textures de son univers, et le rendu ahurissant de l’animation.


Cela ne veut pas dire pour autant qu’il s’agit de la seule alternative pour aborder le cinéma numérique. Steven Spielberg (Tintin, Ready Player One), Robert Zemeckis (Le Pôle Express, Beowulf, Le Drôle de Noël de Scrooge) ou encore Alfonso Cuaron (Gravity) ont impressionné pour leurs plans-séquences démesurés, émancipés des limites du tangible. La caméra peut accompagner un chaos totalement organisé dans une chorégraphie démente, traverser la matière, ou la voir transiter d’un élément à un autre.
Au-delà du pur frisson du roller coaster, il y a dans cette approche un questionnement ontologique du numérique. Quand Spielberg montrait un navire halluciné transformer une dune en vague dans Tintin, le pixel était ramené à sa nature d’unité de base, de brique de Lego microscopique capable de tout créer, de tout changer de forme.
On peut d’ailleurs pousser ce comparatif avec Le Roi Lion de 2019, qui n’était au fond que l’équivalent de ces vidéos en Lego s’amusant à recréer des scènes de film, mais avec de la 3D photoréaliste et plus de 200 millions de dollars de budget. De son côté, Mufasa, coincé entre les acquis de son prédécesseur et son histoire “originale”, ne sait plus sur quel pied danser, et reste finalement coincé dans un entre-deux bâtard.


Sans jamais se livrer à de grandes envolées virevoltantes, sa caméra virtuelle n’a pas non plus la rigueur réaliste de celle de Cameron. Dès que les animaux se mettent à courir, l’objectif semble flotter dans l’air, dans un mouvement trop parfait et trop programmé pour incarner son monde virtuel. Ce flottement est permanent, incapable de se rattacher au sol dans ces travellings sans heurts, où le corps des lions sert même dans certains cas à “locker” la caméra sur leurs mouvements. A maintes reprises, je percevais l’image du film de la même manière qu’une caméra de jeu vidéo dans un mode photo, voguant dans l’espace tout en en étant décorrélé.
C’est peut-être le meilleur parallèle à faire avec la mise en scène de Mufasa. Le mode photo d’un jeu vidéo, c’est non seulement une pause, mais c’est aussi le moment où on change de point de vue, où on sort de notre avatar, comme dans une expérience extra-corporelle. Et c’est bien ce décalage qui engendre une distance avec le résultat final.


Dépression de pixels
Dès la sortie du premier Avatar en 2009, certains médias ont recueilli les témoignages de spectateurs dévastés de tristesse en quittant la salle. Le phénomène a vite été surnommé “syndrome de dépression post-Avatar“, traduisant chez une partie du public l’envie de ne plus quitter l’univers enchanteur du film, et la réalisation d’un décalage entre le monde de la fiction et le difficile retour à notre réalité.
Plus qu’une simple fascination pour un imaginaire que l’on ne peut rejoindre, le syndrome martèle la véritable démarche de James Cameron. Pour ceux qui se sont moqués de la naïveté écologique du cinéaste, Avatar avait surtout un coup d’avance, reflétant déjà ce sentiment d’écoanxiété que l’on entend désormais partout. On peut même dire qu’Avatar 2 va encore plus loin en la matière, en condamnant définitivement la Terre par le consumérisme humain. La cohabitation sur Pandora est impossible, et la guerre, tant rejetée par la philosophie Na’vi, devient une nécessité pour protéger ce coin de paradis.


Ce que raconte Cameron en creux, c’est que l’utopie ne peut plus exister qu’au travers de la technologie la plus aboutie et précise. C’est toute la tragédie du photoréalisme de la saga. La beauté et la tangibilité de sa biosphère et de ses textures ne sont que le miroir déformant de notre propre planète, celle que nous sommes en train de détruire. Par la manufacture parfaite d’un ailleurs fantasmé, les films nous reconnectent à nos responsabilités, à la fin programmée et indifférente de notre “vrai” monde, faisant moins du cinéma numérique une échappatoire qu’une frontière poreuse – bien qu’infranchissable – avec le réel.
Là encore, Mufasa répond par l’antithèse de la pire des manières. Son envie de réalisme documentaire fait de ses divers biomes traversés par les personnages ces mêmes ensembles de CGI mornes, photographiés avec un manque profond de contraste. Mais surtout, il force notre monde sur l’imaginaire fictif du Roi Lion, pourtant dépourvu d’humains.


Par rapport à ce que je disais plus tôt, Barry Jenkins et ses équipes ne se sont jamais posé la question de la valeur du pixel. Qu’est-ce que je représente avec mes briques de Lego virtuelles ? Quel imaginaire vais-je traduire avec ces technologies impressionnantes ? Là où Avatar fait de sa perfection numérique la projection d’une autre perfection, quant à elle bien réelle et que l’on peut encore préserver, Mufasa fait de ce cinéma de tous les possibles un énième parc Disneyland surréel, reproduisant avec précision de véritables décors et animaux pour mieux les déconnecter de leur réalité.
Il force son simulacre en voulant nous faire oublier ses deux sources : le film d’origine et le monde réel, avec une inconscience embarrassante. Paradoxalement, l’empreinte de l’homme sur ce monde qui en est privé finit par se ressentir dans le moindre pixel. C’est ça le rejet que j’ai ressenti devant Mufasa, que je pourrais comparer à ce moment où Néo ne voit plus la façade de la Matrice, mais le code qui la compose.
Dans ces terres numériques pures, que l’humain ne peut au final pas pénétrer même s’il en est le créateur, l’anticolonialisme explicite d’Avatar s’efface dans Le Roi Lion et son prequel. Cette immensité baignée de lumière n’est plus le royaume des animaux. C’est encore celui des hommes, créant des palliatifs clinquants et vides de sens, simples copier-coller d’une immensité pour le coup de plus en plus baignée dans l’obscurité.