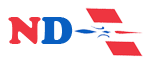« Parler de la colonialité de l’État d’Israël ne signifie pas souhaiter sa destruction »

La nature coloniale du sionisme et, par conséquent, de l’État d’Israël, a été envisagée par les Palestiniens et les premiers sionistes eux-mêmes. Les Palestiniens ont historiquement représenté leur condition comme une forme de domination coloniale ; tandis que le sionisme s’appuyait sur le discours colonial, hégémonique en Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle, marquant inévitablement la construction de l’État d’Israël.éthique Ressortissant israélien.
Le prisme colonial ne saurait donc se réduire à une approche moralisatrice à visée accusatrice. N’en déplaise à ses détracteurs, pour qui l’utilisation de cette grille de lecture serait motivée par la volonté de délégitimer l’existence de l’État d’Israël et n’aurait aucun fondement scientifique.
Si le premier à parler du sionisme comme d’un colonialisme de peuplement fut l’intellectuel et diplomate palestinien Fayez Sayegh en 1965 (1), des voix s’élevèrent aussi dans le monde occidental. En France, dès 1967, Maxime Rodinson émettait l’hypothèse que le sionisme était un mouvement colonial de peuplement dont la Grande-Bretagne servait, à certaines périodes, de mère patrie.
Ces analyses mettent l’accent sur les deux caractéristiques principales du colonialisme de peuplement, que l’on retrouve dans l’entreprise sioniste : le « logique d’élimination » de la population indigène et la remise en cause du modèle « métropole/colonie ». Dans le cas du colonialisme de peuplement, les colons « venir pour rester : l’invasion est une structure, pas un événement « , selon la célèbre formule de l’anthropologue Patrick Wolfe (2).
Éliminer la population indigène
Contrairement au colonialisme dit « classique », ici les colons ne cherchent pas à exploiter la population indigène comme main-d’œuvre, mais à l’éliminer, physiquement ou par assimilation culturelle, pour la remplacer par une nouvelle société coloniale.
Deuxièmement, le colonialisme « classique » tend à renforcer la dichotomie « métropole/colonie », alors que le colonialisme de peuplement vise à l’effacer. La nouvelle société coloniale développe ses propres intérêts qui peuvent concurrencer ceux de la métropole, comme ce fut le cas en Algérie où les colons français se sont opposés à plusieurs reprises aux politiques imposées par Paris.
Autres situations coloniales
Sorti du paradigme de l’exceptionnalité, le cas palestinien entre ainsi en dialogue avec d’autres situations coloniales, d’origine européenne et non européenne : Australie, États-Unis, Kanaky/Nouvelle-Calédonie, Irlande, mais aussi Japon, Tibet, Sahara occidental et Cachemire.
Aux critiques qui voudraient que l’absence de métropole et la dimension nationale du mouvement sioniste soient incompatibles avec la désignation de ce dernier comme mouvement colonial, l’historien Lorenzo Veracini répond que cette approche ne cherche pas à comparer les mouvements coloniaux entre eux, mais plutôt relation qu’ils ont établis avec les communautés autochtones. Il ne s’agit pas de comparer des pommes, mais de voir comment elles tombent. (Le sionisme) est peut-être une belle pomme, mais elle est quand même tombée en Palestine. « , précise-t-il. (3)
L’approche relationnelle et comparative est au cœur du projet épistémologique des sciences sociales. S’il est vrai qu’on ne compare jamais deux choses exactement identiques, il est difficile de comprendre pourquoi le projet sioniste en Palestine échapperait à la comparaison et, en fin de compteà l’analyse socio-historique.
Un cadre d’analyse pertinent
Pourtant, cette question fait toujours l’objet d’un débat houleux, a fortiori depuis le 7 octobre 2023. Les plans scientifiques et politiques sont inévitablement imbriqués, mais les discussions au sein du monde académique gagneraient à être plus dépassionnées : le colonialisme de peuplement constitue d’abord un cadre d’analyse pertinent. Il permet de rendre intelligibles certains phénomènes, passés et présents, qui ne sont pas compris avec une lecture centrée sur l’idée de « conflit national ».
On évoquera l’inégalité des droits entre citoyens palestiniens et juifs à l’intérieur des frontières de l’État d’Israël ; les représentations de « l’autre » palestinien et de la « terre juive » qui puisent dans le répertoire discursif du colonialisme européen, dont l’idée de la supériorité de la civilisation européenne ; ou encore les alliances entre l’État d’Israël et d’autres États coloniaux comme l’Afrique du Sud, les États-Unis ou le Maroc. Cette approche permet d’appréhender l’histoire palestinienne dans la continuité, au plus près de l’expérience des Palestiniens. Car non, tout n’a pas commencé en 1967 avec l’occupation israélienne de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza.
Une transformation radicale
Le fait que ce paradigme circule et fasse l’objet de réappropriations aussi fructueuses que complexes, au point de devenir un cri de ralliement et de mobilisation à l’échelle mondiale, prouve sa vivacité et sa force politique. Le prisme colonial et son corollaire, la décolonisation, sont aujourd’hui perçus par une grande partie du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien comme des notions émancipatrices. D’un point de vue sociologique, nous assistons à une scène dans l’histoire sociale de ces concepts.
Aucun paradigme ne doit être mobilisé de manière rigide et acritique. Comme le montrent aussi les débats animés entre les partisans de cette approche, aucun paradigme ne suffit à lui seul à comprendre une réalité complexe. Néanmoins, ses apports doivent être reconnus. Et nous devons nous résoudre à ce qui devrait être évident pour toute personne honnête et soucieuse de justice : parler de la colonialité de l’État d’Israël ne revient pas à souhaiter sa destruction, mais à exiger sa transformation radicale.