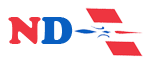Les rites funéraires au Japon : la mort comme passage vers une nouvelle vie

La mort n’est pas une fin, tout au plus un passage fugace vers une nouvelle vie, qu’il convient d’aborder avec sagesse et sérénité, pour qu’elle soit réussie. Vivants, morts… Le Japon n’a pas établi de frontière claire entre les deux États. Et cette particularité remonte à loin.
Durant la période Jōmon (13 000 à 300 ans avant notre ère), celle des chasseurs-cueilleurs, les tombes étaient positionnées au cœur des villages, contrairement à la tradition européenne qui les isolait toujours. À la fin de cette période apparaît la religion shintoïste et ses milliers de kami – des esprits incarnant les éléments (vents, rivières, montagnes) mais aussi les défunts, et accompagnant les hommes dans leur vie quotidienne. Parmi eux, les shinigami, divinités personnifiant la mort, que les prêtres shintoïstes préféraient tenir à distance, les associant à la souillure et à la putréfaction. Les religieux repoussèrent le moment de l’enterrement – ou de l’immersion, puisque les défunts étaient parfois jetés dans la rivière.
A la découverte des ryokan, célèbres auberges japonaises
Le bain mortuaire, un lien avec l’au-delà
Le shintoïsme croit à l’immortalité de l’âme, sans superposer les notions d’enfer ou de paradis. Lorsque la mort survient, les proches, selon la tradition du mogari (« deuil »), récitent des prières. Les nōkanshi (l’équivalent de nos embaumeurs) lavent le corps et l’habillent. « La toilette mortuaire était du ressort des femmes, probablement des nourrices, comme pour baigner un nouveau-né… », écrit le japonologue français François Macé dans « Mort et funérailles dans le Japon ancien » (éd. POF, 1997). Ce bain final mettait le défunt en contact avec une vie après la mort où l’on espérait qu’il renaîtrait.
Les personnages de haut rang bénéficiaient d’un traitement particulier. Lorsque l’un d’eux mourait, les moines construisaient un bâtiment au milieu de la forêt et y déposaient le corps. Il y restait exposé plusieurs mois, entre cet accident éphémère qu’est la vie et l’arrivée à Yomi, le « pays des morts ». Le cercueil doré du légendaire empereur Chùai (149-200), tué au combat, aurait été suspendu à un arbre, et en s’échappant, son âme se serait mêlée à la sève du hêtre et aurait exhalé un doux parfum.
Pour le bouddhisme, la mort n’est que la fin de l’incarnation.
Puis, au VIe siècle, le bouddhisme entre au Japon. Des temples apparaissent à côté des sanctuaires. Surgie de la puissante Chine, cette philosophie monothéiste invente un sentiment jusque-là inconnu du shintoïsme : la culpabilité, sous le regard implacable d’un Dieu. S’il a bu, volé, menti, alors le coupable doit être torturé, racontent les Manuscrits de l’Enfer, deux précieux documents de la fin du XIIe siècle, conservés aujourd’hui au Musée national de Tokyo et à celui de Nara. Vers 1155, l’empereur Go-Shirakawa demande au peintre Tosa Mitsunaga d’illustrer les châtiments réservés aux pécheurs. L’artiste dessine huit scènes d’horreur, des « criminels » dévorés par des chiens, des oiseaux, des vers, ou livrés aux flammes.
Dans la continuité du shintoïsme, le bouddhisme a fait de la mort un moment qu’il ne faut pas craindre, une simple cessation d’une incarnation. Celui qui va mourir doit se libérer de toute émotion pour que la conscience soit délivrée. L’être aimé reviendra l’été suivant lors de la fête des morts, O-bon, importée de Chine au XVIIe siècle. Aujourd’hui, elle reste la fête bouddhiste la plus célébrée au Japon : pendant trois jours en juillet ou en août (selon les lieux), les croyants accrochent des lanternes dans leurs jardins et leurs maisons pour montrer le chemin aux chers disparus, et nettoient et décorent les tombes de fleurs, de fruits et de légumes, tandis que les rues résonnent de la musique accompagnant la danse rituelle, le bon-odori. Réussis ta mort comme tu as mené ta vie…
Le samouraï a laissé un poème d’adieu avant de se suicider
À l’époque féodale, l’idée fut poussée très loin. Le bushidō, code de conduite des samouraïs édicté au XVIIe siècle, stipulait que quiconque avait manqué à son devoir de courage ou de loyauté devait se racheter par un suicide rituel, le seppuku (l’Occident utilise plus souvent le hara-kiri, terme japonais du langage parlé pour désigner l’éventration volontaire). Le malheureux guerrier laissait un jisei, poème d’adieu devenu depuis une tradition littéraire, puis se plantait une courte épée dans le nombril et, dans un ultime acte de bravoure, la portait à sa poitrine.
C’est aux règles d’airain du même bushidō qu’obéirent les kamikazes (littéralement « vent divin »), ces pilotes en mission suicide qui, à partir de septembre 1944, sentant venir la défaite, firent fondre leur avion avec sa bombe de 250 kg sur des navires américains, offrant leur âme à l’empereur Hirohito. Dix mille aviateurs s’immolèrent, avec un faible taux de réussite (10 % de cibles touchées). On sait aujourd’hui que beaucoup de ces jeunes grimpèrent dans leur sarcophage volant ivres de peur et de saké. Refuser cette dévotion mortuaire les aurait exposés à une autre mort, sociale cette fois…
Trois écrivains légendaires ont porté le fardeau de ces années de guerre, qui les ont chacun rapprochés de la mort à leur manière. « J’ai vécu une vie remplie de honte », se lamente Osamu Dazai au début de son magnifique roman « La Chute d’un homme » (1948).

Famille et amis viennent prier au haka, un tombeau de pierre au pied duquel sont déposés des fleurs et de l’encens. Artokoloro / Quint Lox / Aurimages
La défaite du Japon en 1945 et la modernité le dépriment. Il pense que sa mort sera plus parfaite que son existence, mais il échoue. Il tente quatre fois de se suicider, quatre fois il échoue. Rêvant de shinjū – le « suicide amoureux » en vogue depuis le succès de la pièce de Chikamatsu Monzaemon, « Les suicides amoureux à Amijima » (1720), dans laquelle deux amants se donnent la mort –, il y parvient finalement en juin 1948, persuadant une amante de le suivre dans le canal de Tamagawa pour se noyer.
Les autorités japonaises préoccupées par le phénomène de la « mort solitaire »
Quand il s’agit de choisir sa mort, le romancier Yukio Mishima préfère le spectacle. C’est avec le sacrifice mystique des kamikazes et des bushidō en tête que, le 25 novembre 1970, l’auteur des Confessions d’un masque (1949) noue autour de sa tête leur bandeau emblématique, le hachimaki, et se rend au siège de la Société du Bouclier, la milice privée qu’il a cofondée pour protéger l’empereur. Il fume une cigarette, harangue la foule depuis un balcon réclamant la restauration du Japon impérial sous les huées, se retire à l’intérieur et se transperce le corps de son épée avant d’être décapité par un ami chargé de cette tâche. « Mishima est mort comme un touriste s’imagine que tout Japonais doit mourir », écrit Maurice Pinguet dans son essai « La Mort volontaire au Japon » (Gallimard, 1984).
Quant au prix Nobel de littérature Yasunari Kawabata, il a connu un destin peut-être encore plus tragique, celui de ce que les Japonais appellent le kodokushi, la « mort solitaire », phénomène croissant dans une société de plus en plus urbanisée. Écrivain dont l’œuvre a été marquée par son expérience des morts – ses parents, qu’il a perdus très jeune, et les kamikazes qu’il a rencontrés pendant la guerre – Kawabata a dénoncé dans ses romans le naufrage et la perversité de la vieillesse. Le 16 avril 1972, la police retrouve son corps dans une maison au bord de la mer, une bouteille de whisky à côté de lui. Il n’a laissé aucun jisei mais on sait qu’il a fait sienne cette phrase de Sénèque : « La mort est parfois une punition. Souvent, c’est un don. Pour beaucoup, c’est une grâce. »
Cet article est tiré de GEO Histoire n°77, Plongez dans le Japon d’hier pour comprendre celui d’aujourd’hui, de septembre-octobre 2024.
➤ Vous êtes déjà un fidèle adepte du contenu GEO ? Alors pour ne rien rater, découvrez nos formules abonnement pour recevoir GEO chez vous chaque mois en toute simplicité.
GrP1