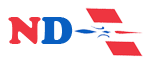les producteurs de betteraves à la recherche d’alternatives aux néonicotinoïdes


Ils sont petits mais ont l’appétit d’un ogre. En cet après-midi de mai, dans un champ de betteraves cultivé par Rodolphe Couturier à Mérouville (Eure-et-Loir), les larves de chrysopes, cet insecte de l’ordre des Neuroptères, s’apprêtent à manger : des pucerons viennent d’attaquer le pont. Capables d’en dévorer une cinquantaine par jour, les larves sont de précieuses alliées dans la lutte contre la jaunisse, cette maladie virale transmise aux betteraves par les pucerons. 50 000 larves par hectare viennent d’être relâchées grâce à un engin tiré par un tracteur.
Cette expérimentation fait partie de celles menées par l’Institut technique de la betterave (ITB) dans le cadre du Plan national de recherche et d’innovation (PNRI) lancé par le gouvernement en 2020. Cette année-là, la France subit de graves crises d’ictère : les betteraviers français payent le prix de l’interdiction des néonicotinoïdes. Ces insecticides d’enrobage des semences (ils pénètrent dans la plante dès la germination) utilisés depuis 1993 éliminent quasiment le risque de jaunissement. Mais ils ont eu des effets délétères sur la biodiversité, notamment sur les pollinisateurs.
Depuis trois ans maintenant, des équipes de l’ITB et de l’Institut national de recherches sur l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) travaillent sur des alternatives qui ne fragilisent pas les rendements. L’enjeu est de taille : la France est le deuxième producteur mondial de sucre de betterave derrière la Russie. Et le risque d’épidémies d’ictère pourrait augmenter avec le réchauffement climatique.
L’ensemble du secteur est actif
Au total, 20 millions d’euros, dont 7 millions d’argent public, ont été mobilisés depuis 2021, auxquels le gouvernement a ajouté 4 millions supplémentaires jusqu’en 2026. Au-delà de l’État, c’est donc l’ensemble du secteur qui s’active pour compenser le absence de néonicotinoïdes. Dans le cadre de ce plan, les équipes de recherche ont notamment mené des travaux d’identification de plantes qui jouent le rôle de réservoirs de virus (le puceron s’y contamine avant de propager la maladie).
De leur côté, les semenciers mènent des recherches pour développer des variétés tolérantes au jaunissement. Et dans les champs, une batterie de leviers est donc testée par l’ITB : les chrysopes fournies par la société Koppert, mais aussi l’épandage de granulés odorants. Conçus par la société Agriodor, diffusant une odeur de clou de girofle, ils agissent comme répulsifs, éloignant les pucerons des parcelles.
Autre mécanisme testé : la diffusion de phéromones pour attirer les prédateurs ou la pulvérisation d’une solution comprenant du lecanicillium muscarium, un champignon parasite qui s’attaque aux pucerons.
Des insecticides toujours utilisés
Mais pour l’instant, le levier le plus répandu, qui est aussi le seul à être homologué, reste la méthode « plante compagne » consistant à semer une herbe, par exemple de l’avoine, entre les betteraves. « Les brins d’avoine perturbent les signaux visuels et olfactifs des pucerons ; Cela perturbera leur atterrissage. », explique Fabienne Maupas, directrice de la recherche technique et scientifique à l’ITB. Au bout de quelques semaines, pour éviter que l’avoine ne concurrence la betterave en puisant de l’eau et des nutriments, elle sera détruite avec un herbicide.
Sur la parcelle de Rodolphe Couturier, ce n’est pas le seul pesticide utilisé. Des aphicides (insecticides ciblant spécifiquement les pucerons, ndlr) ont été pulvérisés à quatre reprises. « Ces insecticides sont efficaces pendant une dizaine de jours alors que les néonicotinoïdes étaient efficaces pendant 90 jours. D’où la nécessité de pulvériser plusieurs fois le pulvérisateur. Les 30 ou 20 % de pucerons restants suffisent à propager les jaunissements. Pour réduire au maximum le risque, les agriculteurs ne peuvent se passer d’alternatives. explique Fabienne Maupas.
C’est là toute la complexité de la transition qui s’opère actuellement. La libération de néonicotinoïdes puissants n’est pas, dans tous les cas, synonyme de réduction du recours à la chimie. « Avec chaque solution, chrysopes, granulés odorants et plantes compagnes, on peut réduire la quantité de pucerons de 30 à 50 %. Ces alternatives mises en œuvre seules ou en combinaison peuvent être suffisantes dans les zones à faible pression de pucerons. Mais dans ceux où la pression est forte, comme ici en Eure-et-Loir, le recours aux insecticides reste indispensable. » poursuit le chercheur.
Coût de production plus élevé
C’est dans ces domaines que l’équation est la plus délicate. Les alternatives proposées doivent être suffisamment efficaces pour réduire le nombre de passages au pulvérisateur. Si l’agriculteur se retrouve obligé de les multiplier, il pourrait finir par abandonner la culture de la betterave. Car outre les risques sanitaires, la pulvérisation d’insecticides représente un coût financier.
Rodolphe Couturier a fait ses calculs : au temps des néonicotinoïdes, il payait 33 € l’hectare, aujourd’hui la facture s’élève à 235 € l’hectare pour les applications d’insecticides, à quoi s’ajoute la main d’œuvre. travaux, gasoil… Et c’est sans compter le coût des trois alternatives testées sur sa parcelle (chrysopes, granulés odorants et plantes compagnes) qui sont désormais prises en charge par le PNRI. Au total, cela représente environ 1 000 € par hectare. « Les chrysopes et les granulés odorants sont chers aujourd’hui mais à mesure que le marché se développe, les prix vont baisser », explique Fabienne Maupas.
À l’avenir, sur qui se baseront ces coûts de production ? « Est-ce l’agriculteur qui devra assumer les conséquences financières d’une décision, l’interdiction des néonicotinoïdes, qui lui a été imposée ? Ou est-ce que ce sera le producteur de sucre qui les répercutera sur le consommateur, ce qui entraînerait une augmentation du prix du kilo de sucre de quelques centimes seulement ? « , » demande Rodolphe Couturier, élu au sein de Tereos.
La question rappelle, une fois de plus, que la libération des néonicotinoïdes n’est pas une tâche facile. « Les politiques ont fait une erreur en pensant qu’on pourrait déployer une solution en trois ans, conclut Fabienne Maupas. En moins de cinq ans, c’est impossible. »