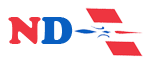« Le Front populaire, c’est l’idée que face aux travailleurs unis, le fascisme ne réussira pas »


La Croix : Quel regard portez-vous, à partir de votre travail sur cette période, sur le nom choisi par les partis de gauche pour ces élections législatives ?
Michel Winock : Un nom approximatif à vocation mythique. Le Front populaire de 1936 est resté longtemps un moment fort de son histoire à gauche. Ceci pour deux raisons : l’unité réalisée entre les partis politiques et les mouvements habitués à se faire la guerre entre eux. Les voici rassemblés au nom de « l’antifascisme ».
Mais le plus important a sans doute été le mouvement de grève sans précédent qui a suivi la victoire électorale des trois principaux partis de gauche. Ces grèves du 36 juin poussent le gouvernement du socialiste Léon Blum à prendre des mesures fortes de politique sociale, dont la plus mémorable est certainement celle des congés payés. Les images et photographies des ouvriers découvrant la mer ont imprégné les mémoires.
Dans quel contexte le Front populaire est-il arrivé au pouvoir en 1936 ?
MW : La formation du Rassemblement Populaire devenu le « Front Populaire » a une double origine. La journée de manifestation sanglante du 6 février 1934 des ligues devant le Palais-Bourbon provoqua une revendication d’union de la gauche contre le fascisme menaçant, une volonté très répandue d’unifier les forces de gauche qui se faisaient la guerre, notamment la fin des attaques incessantes du PCF contre le Parti socialiste, qualifié de « social-traître » ou de « social-fasciste ».
La journée du 6 février n’a en rien décidé le Parti communiste à changer de ligne. Ce n’est que fin juin 1934 qu’il propose aux socialistes un pacte d’unité d’action. En effet, entre-temps, la stratégie de Staline et du Komintern a pris un tournant. Le maître du Kremlin, qui est aussi le leader du communisme international, a compris tardivement le danger que représentait Hitler.
La grande manœuvre sera l’appel à tous les partis communistes à former une alliance avec les socialistes et avec la bourgeoisie libérale pour s’opposer au nazisme. De ce virage docilement exécuté par le PCF, l’union socialiste-communiste s’enrichira de l’adhésion au parti radical – jusqu’alors premier parti politique français. Un programme limité est signé entre les trois partis, qui appliqueront, pour les élections, la « discipline républicaine », c’est-à-dire laisseront l’avantage au second tour, dans chaque circonscription, au candidat de gauche le mieux placé. .
Quel a été le résultat?
MW : Le bilan politique est médiocre, puisque le gouvernement Blum a été renversé par le Sénat, où les radicaux se sont opposés à ce qu’ils ont appelé la politique « ouvriériste » du gouvernement. N’oublions pas que le parti radical représentait largement des ouvriers indépendants, des artisans, des commerçants, une partie des paysans, des chefs de petites entreprises qui ne supportaient pas les nouvelles charges de politique sociale qui pesaient sur eux. L’union de la gauche se disloque définitivement en 1938. Le bilan économique est médiocre, les effets désastreux de la crise économique mondiale en France n’ont pas été surmontés.
De la politique sociale, restent surtout les deux lois majeures, sur les 40 heures (de travail par semaine) et sur les deux semaines de congé payé, la scolarité obligatoire portée à 14 ans (Jean Zay), la création de comités d’entreprise, les fondements d’une politique culturelle, etc. Par la suite, des décrets-lois assouplirent la loi des 40 heures au moment où le réarmement imposait un travail supplémentaire, tandis que l’inflation annulait les augmentations de salaire. Mais les congés payés ont, en quelque sorte, immortalisé le Front populaire. Pour le comprendre, il faut savoir quelles étaient les conditions de travail à l’époque et ce que pouvaient représenter des vacances.
Que représente le Front populaire dans l’imaginaire collectif français ?
MW : Je ne sais pas ce que c’est aujourd’hui, à une époque où la connaissance de l’histoire n’est pas très réputée. Pour les Français âgés de sensibilité de gauche, le Front populaire a constitué une grande étape dans l’histoire de l’émancipation ouvrière.
La figure de Léon Blum n’a-t-elle pas tendance à se démarquer aujourd’hui ?
MW : Comme Jean Jaurès, Léon Blum est une référence pour les gauchistes français. Mais il a été durement, voire violemment attaqué par les communistes, on l’a peut-être oublié aujourd’hui. Marxiste de formation, il évolue vers la social-démocratie, c’est-à-dire un socialisme démocratique et réformiste, comme en atteste son œuvre. À échelle humaine.
Désireux d’ouvrir le parti socialiste après la Seconde Guerre mondiale, notamment aux résistants chrétiens, il est mis en minorité par les autorités de son parti, dont Guy Mollet prend la tête. Mais, au-delà des réalités partisanes, Blum force le respect, même de la part de nombre de ses adversaires, par son courage, son intelligence et cette forme de modération, nullement synonyme d’immobilité ou de conservatisme, qui fait si souvent défaut dans les discours. à partir de la gauche.
Quels sont les mythes autour de cette période, à gauche comme à droite de l’échiquier politique ?
MW : Surtout le mythe de l’union des forces populaires. Mais aussi le mythe de l’antifascisme : face à des travailleurs unis, le fascisme ne passera pas. Et celle de la législation sociale obtenue grâce aux luttes du mouvement ouvrier : c’est à ce moment-là que la CGT et la CGTU, les deux grands syndicats français, fusionnent en une seule CGT, que les communistes finiront par contrôler après la guerre.
Il faut voir les images, photos et films, sur les occupations d’usines et autres établissements, c’était une première, et cela concernait des salariés qui souvent n’avaient jamais fait grève, qui n’étaient pas syndiqués : qu’on pense notamment aux salariés de grands magasins. Cette grève a été vécue comme une joie par les grévistes (ce n’est pas tous les jours qu’on voit la lutte des classes se manifester au son de l’accordéon) et comme un cauchemar pour les patrons. Pour les électeurs de droite, le Front populaire représentait le début de l’apocalypse, la menace du Grand Soir.
Compte tenu de ces différents éléments, est-ce une référence qui peut aujourd’hui soutenir la gauche ?
MW : Peut-être pour une partie de la gauche, la partie la plus âgée. Mais, quand je vois la décrépitude dans laquelle est tombé le réflexe de « défense républicaine », encore actif en 2002 contre Jean-Marie Le Pen mais complètement désactivé face au Rassemblement national, j’ai des doutes sur la pertinence de la formule. Les grands associés de 1936, que sont-ils devenus ? Le PCF n’est plus qu’un tertre, le parti radical survit à l’état de fantôme, et le PS arrivé premier aux élections de 1936 a vu sa direction balayée par LFI. Le Front populaire de Léon Blum n’est pas dominé par l’extrême gauche.