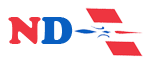« L’abstention devient un mode d’expression démocratique »


La Croix : Comment interpréter le phénomène d’abstention ? Est-ce le signe d’un affaiblissement du rapport au politique ou un acte politique ?
Anne Muxel : L’augmentation est constante depuis une trentaine d’années et touche même le scrutin principal, la présidentielle. Depuis 2001 et l’instauration du quinquennat, les élections législatives apparaissent comme un vote de confirmation de l’élection présidentielle et attirent moins les électeurs qu’auparavant.
L’insistance de l’abstention au fil du temps montre qu’elle est devenue une forme de réponse devenue banale, qui s’est dépouillée de sa connotation sociale négative et qui a gagné en légitimité. Elle était généralement considérée comme le symptôme d’une crise du lien entre les citoyens et leur représentation politique, comme un retrait de la prise de décision électorale lié à une moindre intégration sociale et à divers facteurs sociologiques comme le niveau d’éducation. Ces facteurs sont toujours à l’œuvre, mais ils n’expliquent pas à eux seuls l’ampleur de l’abstention.
Cela semble également véhiculer un message de mécontentement et devient un mode d’expression démocratique à part entière. En ce sens, on se rapproche du vote blanc. Nous l’avons encore observé à travers les études électorales des dernières élections européennes. Un certain nombre d’abstentionnistes peuvent se dire intéressés par la politique, même proches d’une famille idéologique, mais choisir de ne pas y participer, envoyant ainsi un message. L’abstention n’est pas seulement un problème d’offre, car il y a une pléthore de candidats – 38 listes aux élections européennes –, mais un mécontentement à l’égard du système politique en tant que tel.
Vous dites que les élections législatives sont moins attractives puisqu’elles suivent les élections présidentielles mais ce n’est pas le cas de celles qui s’ouvrent.
SUIS: Pour la première fois sous le Ve République, nous avons deux élections intermédiaires coup sur coup. Avec la dissolution, Emmanuel Macron invite les citoyens à prendre position, au nom de la « clarification », et on peut envisager un taux de participation plus élevé. La très forte demande de procurations ces derniers jours montre que la population est réceptive à la gravité de la situation. On assiste peut-être à une séquence de repolitisation. Nous vivons un moment démocratique fort dont les Français peuvent se saisir.
Quel est l’impact des crises que nous vivons sur le lien au politique ?
SUIS: Face à des crises multiples, souvent concurrentes, les individus sont condamnés à s’adapter en permanence. Cela développe la résilience chez certains mais aussi le désespoir chez beaucoup d’autres, alimenté par un sentiment d’impuissance des politiques et une méfiance à l’égard des élites. Les crises alimentent également le radicalisme, comme en témoigne la montée du vote pour le Rassemblement national qui touche désormais toutes les couches de la population.
Les sentiments de colère, de lassitude ou de désarroi sont d’autant plus aigus qu’il existe de moins en moins d’échelons intermédiaires (associations, syndicats, partis) pour réguler la relation avec un État central accusé de ne pas s’occuper des problèmes quotidiens. La réponse est de ne plus faire confiance et de ne plus croire aux politiciens. On s’abstient, on ne vote plus. Pour d’autres, ce même sentiment conduit à des choix plus radicaux.
Toutes les études montrent que les Français sont les champions du pessimisme. Comment expliquer cette spécificité ?
SUIS: Ce profond malaise s’explique d’une part par l’incapacité des partis ou des dirigeants politiques à produire un récit permettant de se projeter dans le futur, de proposer une vision à long terme, face aux multiples évolutions auxquelles nos sociétés sont confrontées. . . Par exemple, l’émergence de l’intelligence artificielle, le réchauffement climatique ou encore les menaces de guerre à nos portes.
L’autre élément d’explication réside dans la place de l’État providence et des services publics. C’était notre marque de fabrique. La disparition des services de proximité ou les difficultés de grandes institutions comme l’hôpital sont perçues comme des signes de son effondrement. Les Français ont le sentiment qu’on leur donne de moins en moins, que ce qui marchait hier ne marche plus aujourd’hui. Le RN l’a bien compris et touche la population sur ce sentiment de perte.
La hausse générale du taux de vote pour le RN reflète-t-elle une société à droite ?
SUIS: Notons d’abord que l’extrême droite est en hausse dans de nombreux pays d’Europe. Ce n’est pas une spécificité française. Une droite fermée portée par les forces du populisme et la volonté de se recentrer sur le national progresse. Cela ne s’inscrit pas dans la tradition d’une droite libérale, ouverte à la mondialisation. Il s’agit donc moins d’une droite de la société que d’un mouvement de recentrage sur les questions nationales, animé par une exigence d’ordre et de sécurité. Les enquêtes montrent également un besoin des Français de se reconnaître dans un leader fort. Marine Le Pen comme Jordan Bardella ont réussi à construire une relation avec leurs électeurs sur ce point. Cette collusion d’une demande de proximité et de protection explique en partie le succès du RN.
L’extrême droite a-t-elle réussi à imposer le sujet de l’immigration ou est-ce vraiment central ?
SUIS: Les enquêtes montrent qu’il s’agit d’une réelle préoccupation parmi les électeurs. La séquence politique dans laquelle le pays est plongé montre qu’elle ne peut être évitée. Les partis d’extrême droite et une partie des médias alimentent certes les craintes, mais celles-ci ne sont pas fabriquées de toutes pièces. Ils renvoient aussi à une perception d’un monde qui se transforme sans qu’on comprenne où cette transformation nous mène. Nous ne répondrons pas au défi de la montée de l’extrême droite sans proposer des projections à long terme.
Il faut aussi comprendre dans la montée de toutes ces problématiques liées aux changements affectant les sociétés occidentales contemporaines une demande de sens de la part de citoyens de plus en plus désorientés. De nombreux dirigeants politiques manquent à la fois de pédagogie et de projets permettant aux citoyens de se projeter dans le monde de demain. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes générations.
En tant que spécialiste de la jeunesse, voyez-vous une particularité dans le vote de la nouvelle génération ?
SUIS: Le vote des jeunes est moins spécifique qu’auparavant. Lors des élections européennes, ils se sont davantage abstenus que la moyenne des Français mais les grandes tendances sont les mêmes. Quant au tropisme de gauche de la jeunesse emblématique des après 68 ans, il s’est depuis longtemps atténué. Le tournant s’amorce au début des années 1990, avec notamment une percée du vote pour Jacques Chirac à l’élection présidentielle de 1995. Dans le même temps, on note une montée et une implantation du vote FN puis RN qui conquiert progressivement une base électorale au sein de la jeunesse.
Cette très forte abstention signifie-t-elle une dépolitisation de la jeunesse ?
SUIS: Pas du tout. Dans tout mon travail, je montre qu’il demeure une politisation qui se manifeste différemment. Des enquêtes montrent qu’environ 40 % des jeunes se déclarent intéressés par la politique. Quand il y a des causes importantes, ils descendent dans la rue pour manifester, signer des pétitions, prendre des engagements communautaires, même si c’est sur des modèles très différents de ceux des générations précédentes. Pendant la crise du Covid, on a vu qu’ils ne se concentraient pas uniquement sur leurs intérêts. Il existe toujours une polarisation politique aux extrémités du spectre politique, plus forte parmi les jeunes que parmi la population moyenne.
Les 18-24 ans ont davantage voté pour LFI et les 24-35 ans davantage pour le RN. N’est-ce pas surprenant ?
SUIS: Non, nous observons cela de manière constante depuis plusieurs années. La période de la jeunesse s’étant considérablement allongée, les 18-24 ans restent souvent avec leur famille et leurs études. L’entrée dans la vie active les confronte alors à des problèmes d’emploi, de mobilité, de logement et d’autonomie. Les jeunes adultes étaient ainsi plus sensibles aux promesses du RN sur le pouvoir d’achat.
Des études ont montré que les jeunes sont attirés par des formes de gouvernement moins démocratiques. Comment expliquez-vous celà ?
SUIS: Dans un récent sondage, un quart d’entre eux estiment que si l’armée gouvernait le pays, ce serait une bonne chose. En fait, depuis plusieurs années, nous observons un double mouvement. A la fois demande d’ordre public et d’autorité pour le collectif. Et en même temps une très grande permissivité dans le domaine des choix de vie et des comportements individuels dans la sphère privée. Dans l’esprit des jeunes, il existe un nouveau type de grammaire morale, qui met l’accent sur le respect d’autrui et la liberté. Cela amène par exemple la nouvelle génération à considérer le sujet de la laïcité différemment, en privilégiant la liberté de chacun d’exprimer et de faire respecter ses convictions.
On voit dans ces revendications d’autorité et de liberté, sinon un paradoxe, du moins une tension. Ce sera l’un des défis de demain. Il s’agira de faire vivre ces nouvelles exigences démocratiques en prenant en compte à la fois cette exigence d’ordre public et de liberté individuelle, dans un monde de plus en plus métissé culturellement. Il faut réinventer le vivre ensemble en mêlant liberté et protection, individuelle et collective, respect de la différence et nécessité de règles de coexistence. Il s’agit d’un défi pour la démocratie qu’il est d’autant plus important de relever que nous voyons émerger chez les nouvelles générations un intérêt pour des régimes forts et potentiellement autoritaires, dans de nombreux pays d’Europe.
Comment expliquer la méfiance des jeunes à l’égard du macronisme ?
SUIS: Emmanuel Macron s’est projeté comme un modèle de disruption politique, comme le grand organisateur d’une entrée dans la modernité libérale, comme l’homme de la rupture avec le soi-disant vieux monde. De toute évidence, le pays n’était pas prêt à cela et les jeunes ne l’ont certainement pas suivi. Plus que de la rupture et de la nouveauté, ce sont des repères et du sens que réclament les populations, y compris les nouvelles générations. Le président n’a pas réussi à obtenir le soutien de la jeunesse que son âge aurait pu lui garantir. Ce fut une occasion manquée et sans doute l’un de ses plus grands échecs.
Il n’a pas fait preuve de la bienveillance qu’exigent des jeunes contraints de s’adapter à un environnement de crise permanente, écologique, politique, sociale, pandémique… Il n’a pas fait preuve d’un sens pédagogique pour tracer une voie crédible pour l’avenir de nos sociétés. Il a à peine répondu aux questions qui les préoccupent.