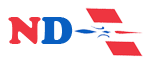« Il n’y a qu’en France qu’on a cette obsession du pouvoir d’achat »

Le professeur de marketing Benoît Heilbrunn décrypte pour BFM Business cette « exception culturelle française » qui fait du pouvoir d’achat le thème principal de toutes les élections depuis des décennies.
Election après élection, mouvement social après mouvement social… Depuis près de deux décennies, la question du pouvoir d’achat est l’obsession nationale. Dans cette campagne législative, cette préoccupation bat même tous les records. Le thème du pouvoir d’achat est cité en premier par 58% des Français selon un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, loin devant la sécurité (36%), l’immigration (33%) ou encore la retraite (18%).
Logique après plus de deux ans d’inflation où les Français vivaient au rythme de la hausse des prix du pétrole et des hausses de prix dans les rayons.
Après le chômage des années 1990, ou la précarité du début des années 2000, le pouvoir d’achat est donc le problème majeur que doivent résoudre les politiques pour espérer convaincre les électeurs.
Mais que se passerait-il s’il n’existait aucune solution ou réponse susceptible de satisfaire les Français ? C’est la question que se pose Benoît Heilbrunn, professeur de marketing et philosophe à l’ESCP, qui vient de publier un brillant essai « Ce que nous cache le mythe du pouvoir d’achat » (Editions de l’Aube). Car si le problème du chômage, par exemple, se résout en créant des emplois, comment satisfaire les attentes en termes de pouvoir d’achat alors que, selon l’auteur, « le désir d’acheter a remplacé le besoin d’acheter » depuis plus de 50 ans ?
Ainsi, selon l’Insee, le pouvoir d’achat a augmenté en France de 8 % sur les 10 dernières années et même de 14 % sur 20 ans. L’auteur propose à BFM Business d’analyser l’émergence d’un phénomène qui se situe à la croisée de l’économie, de la psychologie et du politique.
• BFM Business : Les Français ont-ils une bonne appréciation de leur pouvoir d’achat et des prix en général ?
Benoît Heilbrunn : Toutes les enquêtes montrent clairement que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, les Français ne connaissent pas le prix de ce qu’ils achètent (sauf évidemment pour des achats récurrents comme un café au bar ou un paquet de cigarettes). La plupart sont incapables de donner avec précision le prix des produits qu’ils viennent d’acheter en sortant de la caisse. Ils sont donc incapables d’évaluer l’inflation qui dépend d’une bonne connaissance des prix. Le pouvoir d’achat est donc une donnée psychologique facilement manipulable par les politiques et les acteurs du monde commercial. De plus, l’écart entre la perception et la réalité se creuse. Même si l’on peut contester les mesures de pouvoir d’achat réalisées par l’INSEE, l’écart est criant.
À de rares exceptions près, le pouvoir d’achat progresse régulièrement depuis 1945, d’environ 1 % par an en moyenne. De même, la part de l’énergie – dont on parle beaucoup dans les médias – est relativement stable depuis 30 ans, autour de 9 % du budget des ménages, tandis que la part du logement a fortement progressé sur cette période. La question du pouvoir d’achat est donc essentiellement psychologique et symbolique. C’est un outil de propagande utilisé à loisir par les acteurs du monde commercial et politique qui jouent alternativement sur la peur et la réassurance. C’est aussi le seul point discursif commun de toutes les listes présentes lors des législatives.
• Pourquoi cette question a-t-elle pris une place aussi importante dans le débat public au cours des dernières décennies ?
BH: Tout d’abord, il faut rappeler que le pouvoir d’achat fait partie des exceptions culturelles. Il n’y a qu’en France que cette notion imprègne le débat social et politique. Même dans les pays nordiques, imprégnés de culture protestante et très sensibles à la question du juste prix, le pouvoir d’achat n’apparaît pas dans le discours public.
Il existe plusieurs facteurs explicatifs. Au fond, cela devient un sujet central de débat en fonction de la situation économique, c’est-à-dire lorsque la société se perçoit comme étant en situation de crise économique.
En regardant l’apparition du terme dans la presse, on observe un premier pic à la fin des années 1920 en raison de la crise de 1929, puis à partir de 1973 suite au premier choc pétrolier et enfin, depuis plusieurs années maintenant du fait que l’on entendent parler de la crise à longueur de journée.
La résurgence cyclique de cette expression est alimentée par des peurs et des fantasmes médiatiques comme celui du déclassement. A cela s’ajoutent deux événements majeurs : d’une part, la désindexation des salaires en 1983 suite au gel des prix et des salaires. Elle alimente une crainte des salariés quant à l’augmentation du coût de la vie. D’autre part, je pense que l’idéologie du pouvoir d’achat a été très largement renforcée par la loi de 2009 sur la modernisation de l’économie, qui autorise de fait les distributeurs à prélever des marges rétroactives sur leur prix de vente et légitime de fait la vente à perte (abrogée dans d’autres pays comme l’Angleterre).
Le discours des marques s’est depuis structuré autour de la question du prix dans un pays où les grandes surfaces sont extrêmement dominantes (les hyper et super représentent plus de 70 % de la grande distribution). Ce sont aussi E.Leclerc et Intermarché qui ont le plus profité de la panique autour du pouvoir d’achat entretenue de concert par le monde commercial et politique, c’est-à-dire les enseignes qui ont fait de la lutte contre la hausse des prix leur cheval de bataille.
De cette manière, ces acteurs orientent le discours social sur la question des prix bas, des promotions et des bonnes affaires en positionnant le consommateur comme une victime du système marchand, qui ne peut que s’enrichir de la violence des rapports marchands et d’une défiance envers les acteurs, notamment industriels.
• Quand est née cette notion de pouvoir d’achat ?
BH : En fait, elle n’est pas vraiment née. C’est une de ces notions vagues, pour ne pas dire gélatineuses, qui irriguent le discours social sans que l’on sache de quoi il s’agit. C’est en effet Adam Smith qui introduit cette notion dans ses Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations publiées en 1776. Elle est donc au cœur de la naissance de l’économie politique. Sauf qu’Adam Smith ne l’aborde pas sous l’angle du prix des biens, mais sous l’angle du travail.
Selon lui, la richesse ne dépend pas de l’accumulation de biens matériels, mais du pouvoir que l’on peut exercer sur le travail d’autrui, ce qu’il appelle à juste titre la valeur du travail, notion qui sera largement reprise par Marx. Le pouvoir d’achat signifie la capacité à commander le travail d’autrui pour obtenir les commodités et les plaisirs de la vie. On comprend dès lors que l’avènement de cette notion est concomitant d’une idéologie qui se met en branle à l’époque et que j’ai appelée la tyrannie du bien-être, à savoir que la recherche du confort matériel, social et psychologique devient une obsession qui guide la plupart de nos désirs et de nos actions.
• Vous dites que le pouvoir d’achat est un « désir d’achat » qui ne peut en fait jamais être satisfait, pourquoi ?
BH : Il faut comprendre le caractère addictif du pouvoir et donc le cercle vicieux du pouvoir d’achat. Le pouvoir est cumulatif dans le sens où il appelle toujours plus de pouvoir. Le désir de pouvoir est un abîme sans fin. Et c’est ce mécanisme qui structure la société de consommation. Lorsque la notion de société de consommation est apparue à la fin des années 1960, on a remarqué que le terme « besoins » disparaissait peu à peu du discours et était peu à peu remplacé par celui de « désir ». Or, la caractéristique d’un désir est qu’il ne peut être satisfait, d’où cette course sans fin qui explique évidemment les pratiques de surconsommation qu’il faut désormais stopper pour des raisons environnementales, mais aussi psychologiques, dans la mesure où l’accumulation de biens et de richesses ne nous rend pas plus heureux.
• Quel rôle joue la grande distribution dans cet affrontement politique autour du pouvoir d’achat ?
BH : Son rôle est déterminant, car il lui permet de détourner le débat politique sur la consommation en le portant sur le terrain des prix. Ce rôle est renforcé par la sur-présence médiatique de certains propriétaires de marques qui ont pour effet d’étouffer tout débat sur une nécessaire politique de consommation, en le réduisant à la question du pouvoir du consommateur qui est en fait artificiel car ce soi-disant pouvoir d’achat ne veut absolument rien dire si pas de bluff !
• Le consommateur citoyen perçoit-il la scène politique comme un supermarché et les offres des partis comme des produits qu’il change au gré de ses envies en fonction de ceux qui lui offriront le plus de satisfaction ?
BH : C’est exactement ce qui se passe, sauf que celui qui achète n’assume pas forcément le rôle de citoyen. La rhétorique des prix bas entretient un mécanisme qui est la recherche de la bonne affaire, du prix bas, ce qu’on appelle en économie la recherche de l’effet d’aubaine.
Autrement dit, l’individu gère ses achats en essayant d’optimiser son utilité en fonction de ressources qu’il estime de plus en plus limitées. Cette lecture microéconomique qui établit le chiffre dehomo economique, très souvent critiquée, est à mon avis le seul véritable apport de l’économie à la compréhension des mécanismes d’achat. Cette logique renforce la dimension égoïste de l’acheteur comme l’avait déjà montré Adam Smith et alimente évidemment un mécanisme d’atomisation de la société contre lequel il faut lutter en faisant de la consommation un enjeu de délibération et de lutte collective. La rhétorique du pouvoir d’achat nous anesthésie en nous enfermant sur un petit moi ancré dans sa bulle de confort.
• Quelle place a l’intérêt général dans une société atomisée où chaque individu ne cherche qu’à améliorer son pouvoir d’achat ?
BH: L’orientation du discours social sur le pouvoir d’achat trahit justement la résurgence de la notion de consommateur, figure inventée par le marketing pour décrire un individu qui, contrairement au client, n’a aucun attachement et aucun lien présumé de loyauté à l’égard d’un fournisseur.
Il agit en privilégiant son intérêt particulier sur l’intérêt général. C’est donc la résurgence d’un paradoxe qu’Adam Smith a très bien mis en évidence, à savoir que l’être humain combine en permanence une sympathie naturelle envers ses semblables et se soucie de leur bien-être, tout en étant résolument égoïste et en essayant de faire passer son propre confort avant lui.
Ce n’est pas un hasard si le contrepoids idéologique et culturel que nous avons produit pour contrer cet égoïsme maximisateur n’est autre que la responsabilité individuelle, qui nous permet de culpabiliser nos actes d’achat. En un sens, la rhétorique du pouvoir d’achat oblitère la souveraineté du citoyen qui consomme en déplaçant le centre d’intérêt vers l’intérêt particulier, alors qu’il s’agit justement de repenser l’intérêt général.
Ce qui veut dire qu’il est important de promouvoir une démocratie plus délibérative qui permette de poser collectivement la question des biens communs, des biens nécessaires pour assurer une vie décente à tous, des dépenses d’infrastructures nécessaires pour vivre mieux, bref de tout ce qui Il manque, à droite comme à gauche, dans les propositions des partis politiques, obsédés comme ils le sont tous par le ballon du pouvoir d’achat.