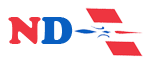Faut-il désobéir à l’Union européenne ?, par Aurélien Bernier (Le Monde Diplomatique, mai 2024)

Alors que les juges français prêtent allégeance aux tribunaux communautaires
Le 9 juin, l’élection des députés européens opposera les partis qui acceptent la primauté des règles communautaires sur les lois nationales. En France, cette suprématie a été renforcée par des décisions de justice et par un consensus entre libéraux et socialistes. En serait-il de même si demain la droite et l’extrême droite dominaient le Parlement européen ? ? Et qu’en pense la gauche ? ?

Rayk Goetze. – « Mise à niveau » (Aligner), 2023
Fdans Juin 1989, Place du Palais-Royal à Paris. La section du contentieux du Conseil d’État enregistre la demande de Raoul Georges Nicolo, conseiller municipal de la commune du Gosier en Guadeloupe. Quelques jours plus tôt, le 18 juin, les Français élisaient leurs représentants au Parlement européen. Nicolo estime que les électeurs étrangers n’auraient pas dû participer au vote puisqu’ils ne résident pas sur le Vieux Continent. L’argumentation est écrite sur une feuille de papier et les juges ont du mal à la comprendre. Mais cette curieuse demande leur offre l’occasion d’écrire un arrêt jurisprudentiel majeur, sans doute le plus décisif en matière d’intégration européenne. Un tournant dans une longue histoire très politique.
En 1951, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) créait une cour de justice. Elle doit régler les différends entre les États membres, mais la convention ne l’élève pas au-dessus des tribunaux nationaux. En matière de droit international, la France adhère depuis les années 1920 à la doctrine dite « matière » (du nom du premier président de la Cour de cassation, Paul Matter) : un traité entre États prime sur une loi si et seulement si il est antérieur à sa ratification. C’est le principe de la loi bouclier : aucune norme, même internationale, ne peut s’opposer à l’expression de la volonté générale par le droit. Quant à la Constitution, elle reste toujours au sommet de la hiérarchie des normes. Après le refus de la Communauté européenne de défense (CED) par les députés français en 1954, le traité de Rome de 1957 vise principalement à promouvoir le libre échange. L’année qui suit l’avènement de la Communauté économique européenne (CEE), la Ve République inscrit la doctrine Matter à l’article 55 de sa Constitution. ; en théorie, le droit français pourrait remettre en cause les principes du traité de Rome. Cette approche contredit celle de la Commission européenne, qui souhaite construire un ordre juridique supranational. Son premier président, le (…)
Taille complète de l’article : 4 023 mots.
Cet article est réservé aux abonnés
accéder à la base de données en ligne de tous les articles du Monde diplomatique de 1954 à nos jours. Retrouvez cette offre spécifique.
Aurélien Bernier
Auteur de La gauche radicale et ses tabous. Pourquoi le Front de Gauche échoue face au Front National, Paris, Seuil, 2014.