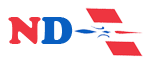Ernest Pignon-Ernest, pionnier du street art, raconte son histoire

Il nous a donné rendez-vous à La Ruche, son atelier depuis 1973. La Ruche, ce havre de paix et de création au coeur du 15ème arrondissement. A l’occasion de la sortie du livre de Pascal Bonafoux, historien de l’art, Dessin, mémoire, poésie publié chez Actes Sud sur soixante ans de création d’Ernest Pignon-Ernest, l’artiste revient sur son art. Un art unique, reconnaissable entre tous sur les murs de Naples, Paris, Anvers ou Port-au-Prince. Ses dessins sérigraphiés sur papier journal et collés aux murs sont devenus des icônes. Ils ne sont jamais détachés ni endommagés. Preuve que cet éphémère est sacré.
Son Rimbaud coincé à Paris et Charleville en 1978 est son œuvre la plus célèbre, mais avec ce livre, on redécouvre aussi et surtout son amour pour la peinture italienne du XVe au XVIIe siècle. Caravage en tête.
Franceinfo Culture : On a beaucoup écrit sur vos œuvres et votre travail. Qu’apporte le livre de Pascal Bonafoux et qu’est-ce qu’il vous a fait découvrir sur votre démarche ?
Ernest Pignon-Ernest : C’est vrai, il existe beaucoup de livres sur mon travail, mais personne n’avait autant ressenti cet intérêt pour la peinture. Et le rôle qu’elle joue et le rôle que je lui fais jouer, que même moi je n’avais pas mesuré. Pascal Bonafoux me fait découvrir comment cela résonne à travers le temps, cette quête de donner de la profondeur à ce tableau. Et il a trouvé cette superbe citation de Van Gogh qui dit : « Je ne fais pas de citations, je fais des traductions. » C’est l’idée que je donne une nouvelle vie à ces détails.
Votre projet est donc de faire revivre des détails des œuvres des grands peintres que vous exposez sur les murs ?
Je veux que les images soient une connaissance plutôt qu’une illusion. Et donc en même temps, je sais qu’il y a un effet réaliste et en même temps, je dis attention, c’est une image. Je vous montre une photo, c’est juste une photo. Comme le disait Godard, ce n’est pas une image juste, c’est juste une image. Et donc, quand je fais mon dessin, je suis traversé par cette contradiction, assez d’effets réalistes, assez d’effets de distance. L’effet réaliste, c’est un peu schématique, c’est la grandeur. La distance est en noir et blanc, la feuille de papier blanche, tu vois ? J’affirme la convention du dessin. Cela m’oblige à être rigoureux. J’aimerais que mes images, quand on les voit dans la rue, soient comme des empreintes de pas. Dans l’idée d’une empreinte, c’est comme un pas dans le sable, c’est-à-dire qu’elle affirme à la fois une présence et une absence..
Ce tableau traverse Naples et ses peintres. Comment expliquez-vous cette fascination pour cette ville ?
Ma première passion était le Greco. Mon premier voyage à 18 ans était à Tolède. Après c’est la Toscane, j’éprouve de l’admiration, de la passion pour la Toscane, pour cette culture. Ensuite, c’est Naples, c’est la rencontre avec la ville, sa réalité physique, historique et symbolique. C’est cette ville qui m’a amené à l’œuvre du Caravage. Quoi qu’il en soit, c’est évident. A Naples, on ressent très, très fortement cette idée de la mort. C’est à cause du Vésuve, des effets de mémoire sur cette ville. C’est peut-être la ville la plus ensoleillée d’Europe et en même temps, il y a constamment cette confrontation entre la lumière, l’ombre et l’obscurité.
Est-ce aussi une ville qui a beaucoup souffert ?
Cette ville est incroyable. Au XVIIe siècle, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu la peste, il y a eu les Espagnols qui les ont écrasés avec leurs impôts, et c’est à ce moment-là que Pergolesi, Carlo Gesualdo, Salvator Rosala musique, l’architecture, la peinture se sont développées. C’est le siècle où la culture est la plus extraordinaire.

Pour décider des emplacements de vos œuvres, il faut connaître tous les coins et recoins de la ville…
J’ai dû coller entre 200 et 300 images à Naples. Dans ma bibliothèque, j’ai 94 livres sur la ville, j’ai tout lu de Virgile à Erri de Luca, je pense avoir tout lu sur Naples. J’ai donc une connaissance approfondie des lieux. Et mes images, après avoir beaucoup marché dans les rues, je les collerai dans les lieux où elles renaissent, j’ajouterai une présence à ce lieu. C’est-à-dire que je connais l’émotion que provoquera la rencontre avec mes images. Ils sont indissociables de l’histoire du lieu, ils entretiennent une relation dialectique, ils se réinscrivent dans le temps.

Et le Caravage serait pour vous le plus napolitain des peintres ?
Petit à petit, émerge la peinture du Caravage où il y a à la fois une grande sensualité, une présence du corps et en même temps, cette sensualité qui dit quelque chose de sacré.
« Le Caravage pour le Caravage ne m’intéresse pas, il ne compte que par et pour Naples. »
Ernest Pignondans « Dessin, mémoire, poésie »
Cela explique-t-il aussi votre goût pour les corps torturés ?
Je suis un grand admirateur de Picasso qui sait faire danser les femmes, courir sur la plage. Je ne sais pas comment faire.
Vous revenez souvent à Picasso…
Le constat que tire Pascal Bonafoux, en fait, c’est que j’ai abandonné la peinture, j’avais le sentiment que je ne pouvais pas. Picasso m’a complètement écrasé. C’est vrai que 90% des choses que je vois en peinture aujourd’hui, Picasso les a déjà couvertes, vraiment. Donc. Alors, j’ai le sentiment qu’après Picasso, on ne pouvait plus peindre.
Revenons sur ces corps torturés et ces citations d’œuvres représentant le Christ, la Vierge, Marie-Madeleine, références chrétiennes pour vous, athée.
Je suis athée, mais en même temps, je suis héritier, en étant peintre, de la culture catholique. Étant peintre, je suis toujours ravi d’être né dans la sphère catholique où le dogme de l’incarnation est un don pour les peintres. J’étais enfant de chœur. Et dans mon village de l’arrière-pays niçois, il y a une Pietà du XVe siècle qui m’a marqué à vie. Je crois à cette idée du corps, de la violence contre les hommes. Vous savez, ma référence la plus forte, celle dont je me sens le plus proche, c’est Pasolini. Les problèmes dans Maman Rome ou dans Accattonece sont des problèmes de petits voyous, de travail, de logement, d’emploi. Mais alors, quand il parle d’un petit voyou venu de Rome, cela devient une quête épique.

Comment expliquez-vous que vos sérigraphies sur papier journal et collées aux murs ne soient jamais vandalisées ?
Quand j’ai collé Rimbaud, je me suis rendu compte que si les Rimbaudiens avaient aimé mon image, c’est parce qu’elle n’est pas figée, comme lui ne l’était pas. C’est René Char qui disait de Rimbaud : « Vous avez réussi avec brio. » Il a écrit pendant trois ans et il a arrêté. N’est-ce pas, faire une image de Rimbaud en marbre comme dans un cimetière n’est pas possible, et le plus rimbaudien dans ma proposition, c’était qu’elle allait disparaître. Et cette disparition fait partie de ma palette. Cela fait partie de la mort annoncée. Elle compte beaucoup.
En revenant à Naples, tout le monde a respecté votre travail.
je je veux ça les gens ressentent cette contradiction : en même temps, ils découvrent mes dessins et on sent que c’est le papier le plus ordinaire qui soit, ils sont des bouts de journaux, très beau journal ordinaire. Mais ce que je propose semble travaillé comme le grand tableau. Je travaille beaucoup. Je crois que cela contribue à l’émotion, au potentiel suggestif autant que ce qu’il y a dans l’image.

Mais vous, cela ne vous attriste pas de voir l’œuvre disparaître ?
Non, c’est comme des fleurs. Vous savez, si les fleurs nous émeuvent, c’est parce qu’elles vont disparaître. C’est un peu le même ordre. C’est cette idée que ça ne peut pas ne reste pas. C’est probablement lié à notre époque, à notre époque, à notre histoire. Nous ne sommes pas à la Renaissance, nous sommes dans une période où nous n’allons pas pas faire des œuvres éternelles, cela n’aurait pas été pas de valeur. Finalement, je pense que nous sommes dans une période de doute, de doute total. Mon métier, c’est le doute permanent.
« Avec le nucléaire, c’est un changement dans l’histoire de la société. »
Ernest Pignonà franceinfo Culture
Quand vous parlez de Renaissance, cela signifie-t-il qu’Hiroshima et le nucléaire rendent ce siècle et le précédent éphémères ?
Ce n’est probablement pas le cas Par hasard si cette manière d’intervenir sur les lieux, je l’ai déterminée par rapport à Hiroshima. Je suis de cette génération qui constate qu’il y a un tournant dans l’histoire de l’humanité avec Hiroshima. En 1965, en l’absence de la Toscane, je suis allé dans le Vaucluse et, à 30 km de là où je viens de m’installer, la force de frappe atomique vient de s’implanter, le plateau d’Albion, vous voyez ? On a dit Hiroshima 1 000 fois, la puissance est terrible. Alors l’idée me vient de travailler sur ce thème, la violence faite à ce territoire, en venant kyster dans cette terre, cet énorme pouvoir de mort.
Mais en peinture, c’est Guernica de Picasso, ce thème. Je veux dire, c’est Guernica ou rien. En faire un tableau était impossible à moins d’être Picasso. C’est ainsi que j’ai réalisé pour la première fois une intervention. Je ne savais pas que ce serait ma pratique. J’ai fait des pochoirs. Je suis parti d’une photo très connue. On dit qu’elle a été prise à Hiroshima, d’un homme anéanti par l’explosion nucléaire dont il ne reste que l’ombre portée. Et à partir de cette ombre portée, j’ai réalisé un pochoir que j’ai imprimé sur les routes, il apparaît comme un fantôme, comme une alerte. Et voilà, c’est la première fois que j’en viens à stigmatiser le paysage. Par une image humaine.

Extrait : « A travers les sérigraphies ou les dessins qu’il colle sur les murs de la ville, Ernest Pignon-Ernest met en lumière ce qu’on y voit comme ce qu’on n’y voit plus. Pour provoquer la réflexion et la mémoire, il cite Le Greco comme le Caravage, Luca Giordano comme Rubens. ou Ingres Ces citations sont des détails de leurs œuvres qu’il récupère ou « corrige », qu’il « traduit » pour que, sur telle ou telle façade, ils trouvent la place que devraient avoir les dessins d’Ernest Pignon-Ernest, parenthèses ouvertes. dans les murs pour que la conscience s’éveille. »
« Ernest Pignon-Ernest. Dessin, mémoire, poésie » de Pascal Bonafoux, Ééditions Actes Sud, 256 pages, 36 euros.