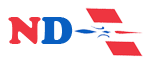Drone : bilan de haut vol

Drone visage
Comment filmer la paranoïa ? En tant qu’art technique, le cinéma entretient une forme de course avec les possibilités technologiques de l’outil caméra, entre attraction et répulsion. D’une part, ces évolutions continuent de renouveler le langage du média et sa grammaire. De l’autre, ils portent en eux les craintes de nos sociétés de plus en plus hantées par l’ultra-sécurité.
Dans les années 1970, Francis Ford Coppola utilisait des téléobjectifs et de longues focales. Conversation secrète cette menace curieuse, capable de zoomer et de scruter la vie de n’importe quel citoyen. Avec les années 90 et 2000, des cinéastes comme Tony Scott (Ennemi de l’État) et Paul Greengrass (Jason Bourne) a opté pour une autre méthode. Le découpage excessif de leurs séquences et la multiplicité de leurs angles traduisaient une échappatoire impossible à la surveillance mondialisée, simplifiée par l’émergence d’Internet.

Mais jusque-là, les caméras étaient encore généralement réparées. Avec l’arrivée du drone militaire, et sa démocratisation dans le pilotage sportif et le cinéma, une autre préoccupation est apparue. Désormais, l’œil mécanique et voyeuriste peut se déplacer partoutavec une facilité et une discrétion déconcertantes. Pourtant, les travellings spectaculaires permis par le drone, et sa capacité à infiltrer des espaces improbables, furent finalement peu exploités par les longs métrages.
Si les clips musicaux et la publicité ont embrassé cette nouveauté esthétique, le septième art en a surtout profité pour remplacer des procédés fastidieux (prises de vues aériennes en hélicoptère). Si nous supprimons Ambulance De ce Michael Bay gravement malade, une course-poursuite dans les rues de Los Angeles où des drones effleurent les murs et plongent au cœur d’un chaos par ailleurs ultra-surveillé, peu de films ont exploité la spécificité de l’outil.

Est-ce un oiseau ? Est-ce un avion ?
A moins, comme les exemples cités plus haut, qu’il faille le prisme explicite du thriller paranoïaque pour ouvrir la voie. C’est pour cette raison que Drone semble aussi moderne que salvateur. Dès son tour de force introductif, prenant la forme d’un long ballet aérien qui suit un joggeur avant de s’arrêter sur les appartements d’un immeuble parisien, cette relecture de Fenêtre sur cour déroule l’étendue assez terrifiante de son terrain de jeu.
C’est d’autant plus malin qu’Emilie (Marion Barbeau) est étudiante en architecture, qui apprend pour ses cours à « réinvestir l’espace »percevoir les lieux et leur utilité sous un nouvel angle. Mais pour pouvoir financer son séminaire et son hébergement dans la capitale, la jeune femme joint les deux bouts grâce au cammingle fait de se livrer à des actes à caractère sexuel en ligne contre rémunération.

Le corps d’Emilie est déjà soumis à un regard dévoreur, qui prend une tournure cauchemardesque lorsqu’un drone se met à la suivre dans son quotidien, récoltant des transferts conséquents. Cet œil neutre, qui se veut à la fois muet et sourd (scènes merveilleuses du point de vue de la caméra, où le son est assourdi) marque d’abord son absence d’humanité. Mais bientôt, il métaphorise une pulsion qui dépasse la machine ; un regard intrusif et obsessionnel, qui nous interroge sur notre propre place dans son système.
Certainement, Drone n’est en soi qu’une réinvention de Voyeur de Michael Powell, porté par un scénario un peu trop évident dans sa structure. Emilie comprend trop tard qu’elle a conclu un pacte faustien avec cette entité abstraite qui s’immisce de plus en plus dans sa vie. Mais c’est aussi en passant à un pur thriller paranoïaque que Drone convainc le plus.


FPV ou FDP ?
Pour son premier long métrage, Simon Bouisson dépasse les clichés attendus sur notre hyper-connectivité et la vulnérabilité moderne de notre intimité. En nous propulsant régulièrement dans le regard de son mystérieux antagoniste tel un Superman omniscient, force est de reconnaître que les montagnes russes ont une part de fascination et d’excitation. Emilie le partage même au début, lorsque le drone l’aide dans ses recherches autour d’un bâtiment abandonné. Bouisson est bien conscient que ses travellings vertigineux possèdent un sens de nouveauté grisant, qui lui sert avant tout à filmer Paris comme jamais.
Plutôt que de se livrer à l’horizon habituel de la capitale, habillé de ses monuments les plus identifiés, le réalisateur et ses pilotes de drones bousculent notre regard sur la ville, et nous entraînent hypnotiquement dans ses suites de veilleuses orange. Rattaché à la banlieue industrialisée de Paris, le film fait de cet urbanisme froid la source parfaite de sa paranoïasurtout quand il transforme un parking souterrain en un lieu d’angoisse oppressante.

Grâce à ce genre de séquence, Drone transforme sa menace volante en véritable croque-mitaine technologique. La beauté enivrante de ses travellings tourbillonnants matérialise ce regard auquel on ne peut échapper. Auparavant, les personnes traquées en fuite pouvaient encore espérer trouver un angle mort, un espace que les caméras pouvaient manquer. Ce que filme Simon Bouisson, c’est la rapidité et l’adaptabilité la plus terrifiante de la surveillance, qui ouvre le récit vers des révélations sordides.
On pourrait aussi reprocher au long-métrage sa fin un peu précipitée, qui abandonne au passage certains de ses personnages secondaires. Mais cette maladresse est excusée au vu de la tournure de sa chasse au trésor. Petit à petit, Emilie se retrouve seule, à la fois proie et dernière fille d’un film d’horreur face à cette métaphore effrayante d’un regard masculin toujours plus violent et abusif. Dans sa prouesse technologique, la machine a avant tout la capacité de déposséder le corps d’autrui, de réifier la vie de chacun. Le vertige (au propre comme au figuré) des tirs de drones n’est pas uniquement dû à leur aspect singulier. Il était temps de leur donner du sens et de la valeur, et Drone le fait d’une très belle manière.