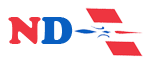CARTE. Visualiser l’emplacement des munitions chimiques et conventionnelles enfouies dans les fonds marins français

Les deux guerres mondiales ont laissé derrière elles des centaines de tonnes de munitions chimiques et conventionnelles (bombes, grenades, torpilles) inutilisées. Depuis 1920, le gouvernement français utilise la mer comme une poubelle pour se débarrasser à moindre coût de ces armes toxiques et dangereuses. Mais où se trouvent exactement ces dépôts de munitions ? Dans un nouveau numéro, diffusé lundi 27 mai sur France 5, l’émission « Vert de rage » tente de reconstituer le plus précisément possible les emplacements de ces décharges, mais aussi la présence avérée de munitions ou de mines dans les épaves.
Cet inventaire, non exhaustif, donne une idée de l’ampleur des immersions, volontaires ou non. Pour ce faire, des données ont été collectées auprès de plusieurs sources : cartes maritimes du Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom), archives de presse, rapports de la Commission Oslo-Paris. Cette convention internationale définit les modalités de coopération pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est.
Certaines de ces zones sont bien identifiées et protégées par des interdictions de plongée, de baignade ou de navigation, établies par les préfectures maritimes et indiquées sur les cartes maritimes. Mais, faute de recensement précis, d’autres zones restent accessibles au public, présentant potentiellement un danger pour les pêcheurs et les plongeurs.
Dès les années 1920, trois méthodes de rejet en mer étaient utilisées pour éliminer les munitions : saborder les navires pour les couler ; le pétard, qui consistait à enterrer des munitions pour les faire exploser (cC’était particulièrement le cas dans la Baie de Somme) ; et l’immersion des munitions, par avion, sous-marin ou bateau, dans des endroits plus ou moins profonds, et peu fréquentés par les bateaux, comme la tranchée du Cap Lévi (près de Cherbourg) ou celle des Casquets (au nord de Guernesey). Cette technique était la plus répandue. « À partir de 1998, la Marine a fortement réduit les volumes concernés. A cette époque, le volume annuel de matières explosives était inférieur à 10 tonnes par an. »explique la préfecture maritime, qui assure que les dernières opérations ont eu lieu quatre ans plus tard, en 2002.
« Nous les avons jetés dans des zones qui n’étaient ni chalutées, ni travaillées par les pêcheurs. À l’époque, on pensait qu’ils allaient rester là, puis disparaître avec le temps. »
Bertrand Sciboz, chasseur de minessur franceinfo
Le pétard a été pratiqué jusqu’au 30 avril 1997, jour de l’accident mortel du navire Les fidèles, rapporté par France Bleu. Ce bateau de la Marine Nationale avait pour mission d’immerger 1 450 grenades conventionnelles (représentant 600 kg d’explosifs) au large de Cherbourg. Les circonstances exactes demeurent floue, mais certaines grenades auraient explosé avant d’être immergées, tuant cinq personnes et en a blessé dix-sept autres. Mais, selon Bertrand Sciboz, Plongeur sous-marin français spécialisé dans le renflouement d’épavesbien que le nombre de munitions volontairement déversées soit important, « la majorité des munitions présentes dans le milieu sous-marin se trouvent dans des navires de guerre bombardés et naufragés ».
Ces immersions présentent aujourd’hui deux risques majeurs pour la biodiversité : les explosions sous-marines, qui font l’effet d’un séisme pour les poissons, et l’érosion des gaines métalliques protégeant les munitions, qui provoque des fuites de substances toxiques. Dans le cas des munitions chimiques, le gaz moutarde finit par se diffuser dans les fonds marins, infectant les mollusques, les algues, les poissons, et donc toute la chaîne alimentaire. Nous vivons aujourd’hui une période critique puisque les scientifiques estiment qu’il faut entre 80 et 100 ans pour qu’une munition soit finalement endommagée.
La dissémination de ces composants toxiques dans le milieu sous-marin crée également une réaction chimique qui conduit à une hypoxie, un taux d’oxygène insuffisant dans l’eau, étouffant au passage les organismes vivants, selon plusieurs études réalisées en mer Méditerranée. et dans la mer Baltique, connue pour être la plus grande zone de déversement au monde. « Le problème c’est qu’aujourd’hui nous n’avons pas de solution technique pour récupérer ces munitions chimiques »explique Olivier Lepick, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris.
« Il est probable que le remède soit pire que le mal : la manipulation de munitions érodées, qui se trouvent dans la mer depuis des décennies, risque d’accélérer la dissémination d’agents chimiques dans l’eau. »
Olivier Lepick, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique à Parissur franceinfo
Pour les munitions dites conventionnelles, plusieurs techniques existent, comme le contre-minage, c’est-à-dire la destruction des armes avec d’autres charges explosives. Des opérations sont régulièrement menées par les préfectures maritimes, comme à Plouguerneau (Finistère) en octobre 2023. « Les contre-attaques concernent essentiellement les mines allemandes qui étaient les plus dangereuses et les plus fréquentes », explique Bertrand Sciboz. Dans certains cas, les munitions peuvent être « océanisées », c’est-à-dire déplacées vers une zone plus profonde, comme ce fut le cas à Nouméa en mai 2018.
En complément de son travail de recensement, « Vert de rage » a réalisé, en partenariat avec le chercheur Aaron Beck, responsable du groupe de Travaux géomar, demesures de des composants explosifs, comme le TNT et ses dérivés, dont la toxicité est préoccupante. L’équipe a plongé à Fouras (Charente-Maritime), au-dessus d’une décharge d’explosifs répertoriée sur les cartes marines et interdite à la plongée, où dedes milliers de munition de La Première Guerre mondiale fut submergée par l’armée française dans les années 1920. Des échantillons ont également été prélevés sur une épave située dans la Manche, près de Courseulles (Calvados), rouvert à la plongée après avoir subi des opérations de déminage.
Résultat : à Fouras, les tarifs de DANT, une molécule de de dégradation du TNT, atteignent 2 401 nanogrammes par litre (ng/L) dans l’eau. C’est le taux le plus élevé jamais observé par l’équipe de Chercheurs allemands. Le TNT est potentiellement cancérigène et suspecté de nuire à la fertilité, ainsi que de provoquer des malformations génétiques. Un autre échantillon montre 827 ng/L de le tétryl, un explosif toxique utilisé dans le passé, jamais détecté auparavant par les chercheurs. Sable de Fouras contient jusqu’à 2 355 nanogrammes par kilo (ng/kg) de TNT brut. On y retrouve également des niveaux importants de le cobalt, le nickel, l’arsenic et le plomb, qui dépassent les seuils de risques environnementaux.
Même conclusion du côté de Courseulles, où les niveaux de les taux de contamination étaient similaires aux taux observés dans la mer Baltique, où plusieurs milliers de personnes de des tonnes d’armes conventionnelles et chimiques ont été déversées. Des résidus de TNT et de ses dérivés, jusqu’à 242 ng/kg, ont également été retrouvés dans le sable.
A ce jour, le nombre exact de munitions immergées est difficile à estimer et aucune carte officielle et exhaustive n’existe, malgré la promesse du ministère de la Transition écologique d’en réaliser une. En décembre dernier, Patrice Vergriete, alors ministre délégué au Logement, affirmait que le travail interministériel, « étalé sur plusieurs années », étaient en cours, sans en préciser le calendrier. Trois ans plus tôt, Annick Billon, sénatrice centriste de Vendée, avait posé une question similaire au gouvernement, et avait reçu exactement la même réponse.
Comment expliquer la difficulté du recensement ? « Ces immersions ont été réalisées par différents services, en France métropolitaine et en outre-mer. L’administration est tellement complexe qu’elle ne sait pas elle-même où elle met ces dossiers« , argumente Bertrand Sciboz. « Les premières immersions ont été réalisées immédiatement après la Première Guerre mondiale, sans que ces opérations soient nécessairement documentées »ajoute Olivier Lepick.
Toutes les données existantes sont donc produites par des commissions internationales comme la convention Ospar (Oslo-Paris) ou par des associations. Selon Olivier Lepick, un travail de recensement, même s’il n’est pas exhaustif, doit certainement avoir été réalisé par la Direction générale de l’armement (DGA) depuis le début des années 1990. « Le problème est que ces données ne sont pas accessibles au public, et encore moins publiées.« En effet, la France oppose le secret défense à toute question relative au déversement d’armes en mer. Secret défense renforcé en 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
«C’est une question très sensible : quels dirigeants politiques seraient prêts à reconnaître que la France s’est comportée d’une manière aussi inacceptable ? poursuit Olivier Lepick. Ces immersions ont eu lieu à une époque où la sensibilité environnementale était très réduite, voire nulle. » De son côté, la dangerosité des munitions (notamment chimiques) n’incite pas les autorités à diffuser des informations trop précises sur les stocks et la localisation des armes immergées.