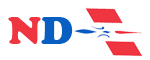apparitions de Marie, révélations… Pourquoi le Vatican vient-il de durcir ses règles pour les reconnaître ?

Près de cinquante ans après la promulgation de normes pour l’étude des phénomènes surnaturels dans l’Église catholique, le Vatican a publié ce vendredi de nouvelles règles. Son objectif ? Évitez les éventuels scandales et toute forme de confusion parmi les fidèles.
Apparitions, larmoiements d’images sacrées, sueurs, saignements, transformation d’hosties consacrées… Tous ces phénomènes surnaturels feront désormais l’objet d’une procédure plus stricte pour les discerner. Signée par le préfet du dicastère pour la doctrine de la foi, le cardinal Víctor Manuel Fernández, une nouvelle note, publiée ce vendredi, donne aux évêques du monde entier de nouvelles directives lorsque de nouveaux témoignages et cas leur arrivent.
Les évêques sont tenus d’adresser à Rome leur avis, que le Vatican doit valider après examen. Sauf intervention du Pape, l’Église catholique ne reconnaîtra jamais le caractère surnaturel d’un phénomène mais pourra simplement accorder un Nihil obstat, c’est-à-dire qu’elle ne s’y opposera pas. Mais alors pourquoi l’Église change-t-elle ses normes ?
Normes de 1978
Les dernières normes procédurales pour discerner les apparitions ou révélations présumées datent de 1978 – approuvées par Paul VI – et n’ont été rendues publiques qu’en 2011. Cette ancienne procédure, qui n’a donné lieu à aucune déclaration publique de la part du Saint-Siège, laissait souvent les fidèles dans l’embarras. « confusion » et les évêques « sans direction claire », explique-t-il.
Le préfet argentin pointe également la lenteur problématique des procédures, estimant que souvent « le discernement ecclésial arrive trop tard ». Il donne pour preuve de ce phénomène que seuls six cas ont été « officiellement résolus » depuis 1950. La diffusion de l’information sur ces phénomènes, note encore le cardinal Fernández, est amplifiée aujourd’hui par l’avènement des moyens de communication modernes, qui nécessitent une « attention supplémentaire » » pour prévenir les dangers qui pourraient survenir.
Une procédure à suivre selon le Vatican
Le Saint-Siège donne aux évêques une procédure détaillée à suivre. Il appartient en effet à l’évêque de chaque diocèse d’examiner les cas de prétendus phénomènes surnaturels se produisant sur son territoire. Il lui est demandé de « ne pas alimenter un climat de sensationnalisme », d’éviter « les manifestations incontrôlées ou douteuses de dévouement » et de s’abstenir « de toute déclaration publique ».
Si le phénomène reste circoncis, l’évêque doit faire preuve de « vigilance ». Si une forme de dévotion se développe, l’évêque ouvre une enquête canonique, créant une commission d’enquête composée au moins d’un théologien, d’un canoniste et d’un expert. Rome insiste sur leur impartialité et la confidentialité de l’enquête.
Tests de laboratoire
Outre l’interrogation des témoins de ces phénomènes, les éventuels objets concernés (déchirure d’images sacrées, sueur, saignement, etc.) doivent être soumis à des analyses en laboratoire.
Par ailleurs, le Saint-Siège donne des critères de discernement positifs et négatifs pour évaluer les phénomènes. Les quatre points « positifs » à considérer sont « la crédibilité et la bonne réputation des personnes » concernées, « l’orthodoxie doctrinale » du message diffusé, « l’imprévisibilité » du phénomène et ses « fruits de la vie chrétienne ».
Les six points négatifs seraient « une erreur manifeste de fait », des « erreurs doctrinales », le constat d’un « esprit sectaire », ou encore une « recherche de profit, de pouvoir, de renommée, de notoriété sociale, » d’intérêt personnel étroitement lié aux faits. », « actes gravement immoraux commis au moment ou à l’occasion des faits » et enfin « altérations psychiques ou tendances psychopathiques du sujet, (…) ou psychose, hystérie collective ou autres éléments relevant d’un horizon pathologique » .
A l’issue de l’enquête préliminaire, l’évêque rédige un rapport avec un avis personnel et transmet tous les actes et son jugement au dicastère. Il appartiendra ensuite à Rome de donner son « approbation finale ».
Et s’il constate « une intention délibérée de mystification et de tromperie à d’autres fins », l’évêque peut même appliquer des sanctions canoniques.