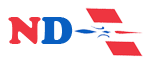A Dakar, une exposition met en lumière les voix des soldats africains de la Première Guerre mondiale


« Imaginez-vous dans la peau d’un Sénégalais des années 1910, prêt à embarquer pour l’Europe sans connaître la destination. », commence le médiateur du Musée des civilisations noires (MCN) de Dakar. Face à elle, un parterre d’étudiants de troisième et deuxième années qui se préparent à un voyage historique à plus d’un titre : la visite des « Echos du Passé », une exposition unique au Sénégal, qui apporte une pierre manquante. dans l’édifice du patrimoine national en présentant 20 archives sonores. Composés de chants, de discussions et même de prières, ils ont été enregistrés dans le camp allemand de Wünsdorf, où 4 000 soldats musulmans, pour la plupart originaires d’Afrique de l’Ouest et du Nord, ont été emprisonnés pendant la Première Guerre mondiale. Le Musée d’Ethnologie de Berlin les a restitués sous forme de dossiers numérisés à l’Etat sénégalais.
Casque allumé, Ismaïla, 14 ans, écoute attentivement : « J’ai reconnu le mot »honte » en wolof », constate-t-il, avant de poursuivre, avec enthousiasme : « Il s’agit de nous et de nos ancêtres, les gens apprendront beaucoup d’informations. Nous sommes nombreux à nous intéresser à ces questions. » En wolof, pulaar, soussou ou fon, langues parlées dans la région, mais aussi en arabe, la majorité des enregistrements, souvent crépitants, ont été réalisés entre 1914 et 1918 dans ce camp près de Berlin. Faisant encore l’objet de recherches, d’autres ont été réalisées au Panoptikum de Berlin, sorte de « zoo humain », lors de plusieurs spectacles donnés par un groupe de Sénégalais en 1910. Un patrimoine et une histoire jusqu’alors largement méconnus à Dakar.
Appropriation coloniale
En plus d’offrir une mine d’informations sur les pratiques de l’époque, « l’exposition permet une reconnexion mémorielle, donne une sépulture à ces prisonniers arrachés à leur terre et redonne leur dignité », explique Massamba Guèye, coordinateur de l’exposition et fondateur de Kër Leyti, la Maison de l’oralité et du patrimoine du Sénégal. Des travaux de recherche, menés par six experts et quinze étudiants au Sénégal, ont permis d’identifier certaines des langues (d’autres restent inconnues), le contexte, mais aussi de retracer le parcours de deux prisonniers sénégalais.
Systématiques et contraints, ces enregistrements ont été réalisés par la Commission phonographique royale prussienne pour la recherche sur les théories raciales. Au total, quelque 2 600 archives sonores ont été recensées. « Il était plus facile de mener des enquêtes sur le sol allemand qu’en Afrique », explique Massamba Guèye. Leur héritage a été retiré aux prisonniers, c’est une appropriation coloniale. » Ainsi, la construction, en 1915, d’une mosquée dans ce camp – la première sur le sol allemand – ne doit pas être un abus. C’était à des fins de propagande pour encourager le soutien à l’Allemagne. « Si on laissait les prisonniers pratiquer leur religion et leur culture, c’était surtout pour les étudier et confirmer les théories racistes de l’époque. », ajoute le chercheur.
Valorisation du patrimoine immatériel
Cette restitution, à l’initiative de l’Allemagne, rare pays à se concentrer sur la restitution de biens culturels immatériels, peut être considérée comme partielle dans la mesure où les enregistrements originaux restent à Berlin. « Ce qui compte c’est le matériel oral, le support en lui-même ne nous intéresse pas »Pourtant, balaye Massamba Gueye.
Elle a notamment été rendue possible par un colloque sur le rapatriement des biens culturels organisé à Dakar en 2018 par l’Institut Goethe. « Le débat sur la restitution a alors soulevé le cas des biens immatériels : comment sauvegarder ce patrimoine oral africain ? « , se souvient Massamba Guèye. Même s’il déplore que le sujet ait été négligé jusqu’à présent, il voit quelques perspectives : « Avec l’exposition, le MCN s’est rendu compte qu’il n’avait pas d’expert en la matière. Un groupe d’une quinzaine d’étudiants a donc été créé pour se former à la recherche collaborative sur le patrimoine immatériel.» Le chercheur réclame un fonds de promotion et de valorisation du patrimoine immatériel de l’ensemble du continent, géré par l’Union africaine. » Ildoit avoir une place primordiale dans la préservation du patrimoine car la tradition orale est cruciale en Afrique »il insiste.
Prévue jusqu’au 21 juin, l’exposition se poursuivra dans un centre culturel de Dakar. « Les expositions orales, plus accessibles, peuvent intéresser un public peu habitué aux musées, se réjouit Massamba Guèye, qui ose rêver : C’est l’avenir du musée africain. »
———
Plus de 2 500 archives sonores
Six institutions allemandes et sénégalaises ont collaboré à l’exposition « Echos du passé », qui fait partie d’un projet de « musée collaboratif » entre les deux pays, en cours jusqu’en 2025.
Son coordinateur, Massamba Gueye, souhaiterait pouvoir accéder aux 2 600 archives sonores allemandes, afin de pouvoir identifier les différents enregistrements et assurer leur sauvegarde.
Sur les 35 enregistrements restitués par l’Allemagne, 20 ont été mis à la disposition du public.