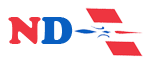ENTRETIEN. D’une « guérilla » à Saint-Louis à une « guerre d’usure » en Nouvelle-Calédonie, l’analyse du chef des unités mobiles de gendarmerie, trois mois après les émeutes

Trois mois après le déclenchement des violences, les exactions se font plus rares en Nouvelle-Calédonie. Mais certaines zones sont toujours aux mains des émeutiers, comme à Saint-Louis. Sur les 1 900 gendarmes mobiles déployés sur le Caillou, deux sont morts et 400 ont été blessés. Ces opérations en Calédonie comptent parmi les plus difficiles qu’ait connues le colonel Cédric Aranda, qui commande le groupe opérationnel de maintien de l’ordre. Entretien.
Trois mois après le début des émeutes qui ont fait dix victimes (huit civils et deux gendarmes) et provoqué la destruction de plus de 700 commerces, les moyens humains de la police sont toujours considérables sur le Rocher. On compte plus de 3 000 policiers et gendarmes, dont 1 900 gendarmes mobiles. Le colonel Cédric Aranda est leur patron. Rarement, lors de ses missions sur le territoire national ou à l’étranger, cet officier de gendarmerie a connu un tel niveau de violence. Il revient sur la situation en Nouvelle-Calédonie.
Nouvelle-Calédonie la 1ère : Trois mois après le début des émeutes, peut-on parler d’un relatif retour au calme ?
Colonel Aranda : Il y a trois séquences dans la crise que nous traversons : une phase de réappropriation du territoire après la crise insurrectionnelle, une phase de consolidation puis une phase de normalisation. La première phase de réappropriation s’est faite sur l’ensemble du territoire, à l’exception de certains points durs, comme Saint-Louis. Nous sommes donc dans une phase de consolidation, de stabilisation, qui tend vers la normalisation. Mais qui reste instable, malgré tout.
D’autres troubles de l’ordre public ne sont pas à exclure.
Sur le terrain, sentez-vous que de nouvelles violences pourraient éclater à tout moment ?
Je ne sais pas si la situation peut exploser avec la même intensité que ce que nous avons vécu car nos effectifs sont bien plus importants qu’au début. Il y avait sept escadrons le 13 mai, contre vingt-sept aujourd’hui (un escadron regroupe environ soixante-dix gendarmes, ndlr). Grâce à ces renforts, notre réponse sera forcément plus réactive et plus offensive, et notre réseau plus fort. Mais de nouveaux troubles à l’ordre public ne sont pas à exclure.
Et pourtant, malgré la présence de 1 900 unités mobiles et de véhicules blindés comme le Centaure, la situation n’est toujours pas réglée à Saint-Louis. Comment expliquer ce statu quo qui paralyse près de 14 000 habitants du sud du Mont-Dore et de Yaté ?
Avant la crise, il y avait déjà des jets de pierres, des fusillades et des détournements de voitures aux abords de Saint-Louis. Mais aujourd’hui, cette zone reste un point dur. Notre objectif est de reprendre pied sur le terrain et de sécuriser la circulation sur cet axe. Nous nous y sommes engagés de manière très offensive et déterminée. Nous avons mené plus d’une quinzaine d’opérations dans le secteur pour dégager et sécuriser la route, et pour escorter la population. Durant toutes ces opérations, nous avons été systématiquement attaqués avec des armes à feu, de manière très violente. Lors d’une opération menée juste avant le 14 juillet, nous avons essuyé cinquante-huit tirs. C’était à balles réelles et avec des armes de gros calibre. Le secteur de Saint-Louis reste dangereux. Nous ne pouvons raisonnablement pas engager une population civile dans cette zone.
Est-ce par peur de perdre des vies humaines qu’il n’y a pas eu de réelle offensive dans ce secteur ?
Cette hypothèse d’intervention n’est pas écartée. Mais aujourd’hui, nous sommes plutôt dans une dynamique d’identification, de recherche d’informations à des fins d’arrestation. Nous savons qu’il y a des noyaux durs et que ce n’est pas toute la tribu qui est dans cette dynamique. Il y a un gang qui sème la terreur, pas seulement sur la route, mais même au sein de la tribu de Saint-Louis. Les gens ont peur de parler car ils craignent des représailles. Nous n’excluons pas la possibilité d’entrer en contact avec l’un des acteurs pour comprendre et essayer de négocier, voir quelles sont leurs attentes, les issues possibles… Nous sommes constamment dans une logique de désescalade et de négociation. Mais cela n’enlève rien à notre détermination.
Leur mode d’action est celui des combattants, ils sont très entraînés.
Deux immenses barrages routiers ont été érigés par la police sur la RP1 de chaque côté de Saint-Louis. Comment cela fonctionne-t-il concrètement aujourd’hui ?
Ces check-points (à Thabor et à La Coulée, ndlr) sont là pour contrôler tous ceux qui entrent et sortent, et aussi pour protéger nos policiers. Nous avons choisi de cloisonner la route, de manière à travailler sur différents modes d’action. Nous continuons à contrôler la population qui y vit, à chercher du renseignement et à l’utiliser à des fins légales. Nous avons affaire à un adversaire qui est hyper mobile, hyper agressif, qui nous tire dessus à balles réelles, sans que nous puissions jamais le localiser et l’identifier. À Saint-Louis, nous sommes vraiment dans une forme de guérilla, avec un mode d’action qui est celui des combattants. Ils ont des positions de tir que nous avons pu identifier, des armes à feu qui circulent et une structure qui est très militarisée. Nous avons affaire à des adversaires entraînés car ils tirent de manière très précise, même à plusieurs centaines de mètres de la cible.
Ces armes sont-elles autres que des fusils de chasse ?
C’est difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il existe des armes de chasse de très gros calibre, ainsi que l’utilisation de jumelles qui permettent de tirer de jour comme de nuit. On pourrait comparer ces modes d’action à ceux des chasseurs car ici, on chasse effectivement de nuit et de jour. C’est une pratique culturelle avec des postes de tir pour observer le gibier. Si on parle de guérilla, c’est parce qu’il y a une coordination très structurée des tirs.
La plupart des gendarmes mobiles présents sur le terrain n’ont qu’une vingtaine d’années. Étaient-ils préparés à un tel niveau de violence ?
La situation est, globalement, exceptionnelle. Nous intervenons assez rarement à ce niveau d’intensité. Mais en tant que gendarmes mobiles, c’est une situation pour laquelle nous sommes formés et entraînés. Les crises se multiplient sur le territoire national. Et notre centre de formation en métropole prépare les unités mobiles à faire face à ce type de situation. Nous intervenons également en opérations extérieures, c’est-à-dire à l’étranger. Nous effectuons des missions de paix, des missions de crise, voire des missions de guerre. Certains d’entre nous sont allés en Afghanistan, en Macédoine, au Kosovo ou encore en Côte d’Ivoire.
C’est une guerre d’usure.
Vous avez également été en mission à l’étranger. Quelle est votre perception de la violence ici ?
Oui, la Nouvelle-Calédonie est l’un des engagements les plus intenses que j’ai vécu. Très clairement. Les gendarmes sont pris pour cible. Nous sommes vraiment le réceptacle des tirs, des tensions, de cette rage de la jeunesse… On avait vu cette colère contre les institutions lors de manifestations comme les gilets jaunes ou les émeutes dans les banlieues. Mais là, on est à des niveaux très intenses. Et par rapport aux émeutes, on est sur quelque chose qui s’inscrit dans une histoire au long cours. C’est une guerre d’usure. On a encore plus de 400 blessés dans nos rangs. Cela représente un gendarme mobile sur sept.
À Mayotte, on retrouve le même niveau de violence de la part de l’adversaire. Mais il n’y a pas d’armes à feu. C’est la grande différence avec la Nouvelle-Calédonie.
Des zones ont également été piégées…
Oui, avec des plaques dégoûtantes qui avaient été retirées et des piquets à l’intérieur. Un policier a été grièvement blessé. Sur la route, nous avons vu des fers à béton plantés dans l’asphalte pour crever nos pneus et nous ralentir. Nous avons également subi des attaques tous azimuts avec des formes d’embuscades. A Mayotte, j’étais le chef opérationnel de Wambushu (une opération visant à lutter contre la criminalité, l’immigration clandestine et l’habitat insalubre dans l’archipel mahorais, ndlr). Le niveau d’engagement était inférieur à celui de la Calédonie. Quant à la violence de l’adversaire, elle était identique à une exception près, c’est qu’à Mayotte, il n’y a pas d’armes à feu. C’est la grande différence avec la Nouvelle-Calédonie.
Vous parlez d’insurrection et non d’émeutes en Nouvelle-Calédonie. Est-ce à cause de sa dimension politique ?
Non, je n’associe pas la terminologie à une dimension politique mais à une lecture tactique et opérationnelle. Par rapport au niveau d’intensité également. On sent une volonté de « payer le gendarme », si je peux dire. Depuis le 13 mai, on est passé de 7 à 27 escadrons de gendarmes mobiles en Calédonie, alors qu’en temps normal, il y a 21 escadrons déployés dans l’ensemble des territoires d’outre-mer. Actuellement, il y a 1 900 gendarmes mobiles en Calédonie sur les 12 000 que compte la France. Cela montre le niveau de priorité qui est donné à la Nouvelle-Calédonie.
De nombreux Calédoniens craignent un regain de tensions le 24 septembre, date de la reprise de la Nouvelle-Calédonie par la France et devenue symbolique pour le mouvement indépendantiste. Vous y préparez-vous ?
Oui, nous y portons une attention particulière. Nous nous y préparons en travaillant sur différentes hypothèses et différents scénarios. Comme dans toutes les crises, nous en avons tiré des enseignements qui nous permettent de faire évoluer nos modes d’action. En développant le contact avec les acteurs locaux, cela peut nous permettre de trouver des clés ou des grilles de lecture pour aller vers une désescalade et trouver la solution à apporter.