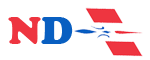Maxime Cumunel est un délégué général de la France Agrivoltaïsme Association. Photo Dr.
Pourquoi les énergiciens et les autres développeurs se tournent-ils vers la nouvelle pratique de l’agrovisme?
«Je crois qu’il y a au moins une centaine de développeurs qui se positionnent maintenant sur ce marché. C’est une forte orientation pour le secteur solaire. Les toits sont chers et restrictifs et les possibilités de grandes centrales électriques sont rares. Il n’y a presque aucun terrain disponible pour ces projets. L’agrivoltaisme est une bonne occasion pour tout le monde. Je pense que cela occupera le secteur au cours des cinq prochaines années. »»
Quelle est l’assemblée financière classique entre un développeur et un agriculteur, et est-ce un revenu supplémentaire important pour les agriculteurs, qui démontrent régulièrement pour leur faible salaire?
«Cela dépend si l’agriculteur lui-même possède la terre. Il faut 2 000 à 4 000 euros par hectare et par an pour partager généralement 50% avec le propriétaire. Si l’installation agrivoltaïque s’étend sur 30 hectares, elle est importante. Mais la plupart des projets réussis s’étendent actuellement entre 5 et 15 hectares, donc le chiffre d’affaires ne sera pas énorme (environ 15 000 euros par an pour un fermier non propriétaire, note de l’éditeur). Ce n’est pas ce qui leur permettra d’aller davantage en vacances. D’un autre côté, il s’agit d’un revenu fixe sur une longue période (entre 30 et 40 ans) et cela leur permettra de perpétuer leur production agricole, y compris par des investissements à long terme pour leur exploitation. Les agriculteurs que je rencontre ne me parlent pas d’abord de l’argent. »»
« Il faut environ cinq ans à un projet agrivoltaïque pour réussir »
Si ce n’est pas surtout un revenu supplémentaire, qu’est-ce qui attire les agriculteurs dans ces technologies?
«C’est le service agronomique. Ils cherchent à améliorer ou à perpétuer leurs rendements et à protéger leurs cultures ou leurs animaux contre les variations climatiques. Ils sont très intéressés par le choix de la technologie. »»
Combien de temps faut-il pour qu’un projet émerge et que prend le plus de temps, maintenant que la France a acquis un cadre clair?
«Il faut environ cinq ans à un projet agrivoltaïque pour réussir. La phase de permis de construction et la connexion au réseau prennent du temps. Il existe également des territoires dans lesquels l’appropriation et l’acceptation du projet peuvent freiner. Pour le moment, nous n’avons que des projets pilotes ou l’état de développement en France. Les premiers parcs agrivoltaïques devraient entrer en service l’année prochaine. »»
« Même dans les territoires les moins favorables, des projets émergent »
En parlant d’acceptation, le Conseil départemental de la vende a élu une motion de censure en décembre contre ce type de projet. Dans certains autres territoires français, les agriculteurs, les résidents ou les municipalités se combinent avec ces systèmes. Comment les rendre acceptables?
«La crainte des territoires est logique et est basée sur certaines préoccupations dans des paysages particuliers, et c’est pourquoi il est nécessaire de travailler sur mesure en fonction des contraintes de chaque territoire. Les projets sont conçus pour être intégrés du mieux que possible en vue des contraintes locales, en particulier en gardant les subdivisions et les sentiers de randonnée, en structurant les haies de paysage. Dès que nous passons deux projets par municipalité, nous notons qu’il y a des problèmes en termes d’acceptation. Cela dépend également de la taille du projet, si la surface est supérieure à 5 à 10% de la zone agricole utile, elle devient plus compliquée. Il est souhaitable que la taille des projets soit raisonnée pour qu’un maximum d’agriculteurs soit inquiet. Mais il n’y en aura pas pour tout le monde, surtout parce que vous devez être proche d’un point de connexion, cela peut nourrir les frustrations. »»
Toutes les régions françaises sont-elles adaptées à ce type de projet?
«Il existe de fortes disparités régionales. Il y a beaucoup de projets dans le Sud-Paca et la Nouvelle-Aquitaine et dans le Grand est, comme dans Meurthe-Et-Moselle et Moselle. Il y en a peu d’outre-mer. Les développeurs souffrent des contraintes les plus élevées dans les zones humides ainsi que les territoires soumis à la loi sur la montagne. Le volontarisme des élus et des acteurs territoriaux est également décisif, comme dans le Grand Est. Mais, même dans les territoires les moins favorables comme la Normandie, des projets émergent. »»